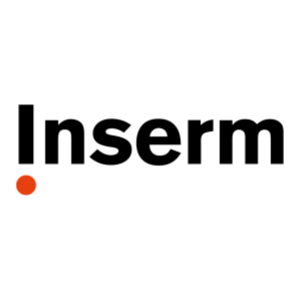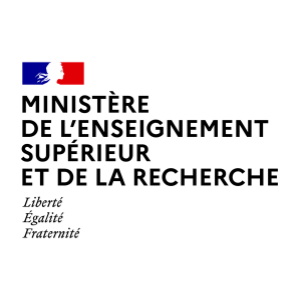Personnes autistes, socialisation et apprentissages. La prise en charge des adolescents et jeunes adultes dans les groupes d’entraînement aux habiletés sociales – Arthur Vuattoux
Résumé de soumission
Contexte :
Dans les dernières années, l’autisme a acquis une légitimité en tant qu’objet de recherche pour les sciences humaines et sociales. Cependant, cette légitimité s’est surtout traduite par des travaux sur les dimensions politiques ou institutionnelles de la reconnaissance de l’autisme. Les travaux consacrés à la prise en charge des personnes elles-mêmes, aux pratiques professionnelles dans le champ de l’autisme, demeurent un « angle mort » de la recherche.
Ainsi, cette recherche, portée par une équipe de sociologues spécialistes de l’autisme, du care, de la prise en charge des jeunes et des institutions sanitaires, enquêtera au plus près du terrain, auprès des professionnels qui concourent au quotidien à la prise en charge des adolescents et jeunes adultes autistes. Le choix des groupes d’entraînement aux habiletés sociales permet de comprendre quelles sont les attentes des professionnels de l’autisme vis-à-vis de celles et ceux qu’ils prennent en charge.
En ce qu’ils portent en eux des attentes concernant le comportement, les relations, les émotions et la cognition des personnes autistes, ces groupes donnent à voir les ressorts de la prise en charge de certaines formes d’autisme dans leur globalité, avec une unité de temps et de lieu qui permet, en outre, de donner prise aux méthodes ethnographiques, à même de saisir dans leur épaisseur les dynamiques sociales à l’œuvre.
Objectifs :
L’objectif principal de cette recherche consiste à saisir la manière dont les groupes d’entraînement aux habiletés sociales, centraux dans la prise en charge de certaines formes de l’autisme, composent avec les dimensions normatives de la vie sociale à laquelle ils sont censés préparer leurs participants. Il s’agit de comprendre comment les propriétés sociales (de genre et de classe notamment, mais aussi d’âge) déterminent la participation des personnes concernées, et comment ces personnes reçoivent les normes et représentations véhiculées lors des séances.
Un objectif secondaire est de comprendre ce que les normes véhiculées dans ces groupes disent des attentes sociales des acteurs qui œuvrent à la prise en charge, et de la société dans son ensemble, en tant qu’elle nécessite, pour y évoluer, la maîtrise de normes rarement aussi explicitement objectivées. Une attention particulière sera apportée à décrire les attentes des professionnels, leurs manières de composer avec les « habiletés sociales » qu’ils ont pour tâche de définir et de mettre en œuvre.
Plus généralement, il s’agit de voir comment s’actualise une tension spécifique au champ de l’autisme entre une prise en charge qui respecte l’identité des personnes d’une part, et l’adaptation aux attentes de la société d’autre part. Tout porte à croire que les ressorts à l’œuvre dans les groupes d’entraînement aux habiletés sociales peuvent éclairer d’un jour nouveau les processus de conformation sociale, la tolérance de la société et des acteurs de la prise en charge vis-à-vis des écarts à la norme, ou encore les difficultés spécifiques rencontrées par les personnes dites autistes face à l’apprentissage des règles du jeu social.
Méthodes :
La méthode choisie pour ce projet est basée sur l’observation de longue durée de groupes d’entraînement aux habiletés sociales (enquête ethnographique). Il s’agira d’observer le fonctionnement de groupes dans deux territoires (Région Ile-de-France et Région Grand-Est). L’observation sera menée dans différents groupes (4 au total), en se basant sur leurs temporalités propres (souvent une année scolaire), afin de comprendre la temporalité de la prise en charge, et de mieux saisir les spécificités d’un travail réalisé sur la longue durée auprès des personnes diagnostiquées autistes.
Un volet d’enquête par entretiens avec les personnes désignées autistes, leurs proches et les professionnels participant aux groupes d’entraînement aux habiletés sociales, sera également réalisé (objectif minimal de 50 entretiens approfondis). Les entretiens avec les professionnels comme ceux avec les adolescents et jeunes adultes seront réalisés sur la base du volontariat (des autorisations seront demandées concernant les mineurs auprès de leurs représentants légaux).
Le protocole de recherche contiendra un volet « restitution » qui vise à faire dialoguer les résultats de la recherche auprès des personnes concernées, sans qu’il s’agisse, au sens strict, d’une enquête participative. L’ensemble de l’équipe de recherche s’impliquera dans l’enquête de terrain, et les résultats de la recherche seront discutés, de la mise en place du projet jusqu’à sa restitution, avec un comité de suivi composé de chercheurs et de membres d’institutions publiques.
Perspectives :
Cette recherche constituera un apport important au domaine encore émergent des sciences sociales de l’autisme, en documentant d’un jour nouveau la prise en charge des personnes diagnostiquées autistes. Au-delà, la recherche vise une réflexion plus large sur la légitimation des normes sociales dans les institutions médico-sociales, mais également sur les arbitrages professionnels présents dans le monde de l’accompagnement social et médico-social, entre respect des spécificités individuelles et nécessité de transmettre aux usagers des attentes jugées essentielles à une expérience autonome de la vie en société.
Synthèse finale du projet
RESUME FINAL du projet de recherche
CONTEXTE
Cette recherche vise à rendre compte du développement de modalités d’accompagnement de l’autisme basées sur les « habiletés sociales ». En effet, les groupes d’entraînement aux habiletés sociales (GEHS) sont en plein essor depuis une dizaine d’années. Ils sont organisés par des professionnel·le·s de l’autisme formé·e·s, en majorité, aux thérapies cognitives et comportementales (TCC), et sont proposés à des personnes autistes dans des cadres divers : suivis en pédopsychiatrie ou dans des cabinets libéraux de psychologues, groupes organisés par des associations ou dans des institutions médico-sociales.
OBJECTIFS
La recherche est structurée autour de deux objectifs principaux. Le premier objectif vise à comprendre la diversité des dispositifs et des professionnalités impliquées dans ce travail sur les habiletés sociales. Le second objectif consiste à questionner l’articulation complexe, voire la tension, dans les groupes d’entraînement aux habiletés sociales, entre normativité et respect de l’autonomie des personnes, notamment dans des groupes destinés à des adolescents et jeunes adultes, ayant donc comme horizon les attentes sociales associées au passage à la vie adulte.
MÉTHODOLOGIE
La recherche est construite sur l’analyse approfondie de quatorze groupes d’entraînement aux habiletés sociales mis en œuvre dans des cadres divers (hôpitaux, cabinets privés, associations, institutions) et destinés aux adolescent·e·s et aux jeunes adultes. Ces groupes ont fait l’objet d’une enquête ethnographique par observation et entretiens permettant, au-delà des seuls groupes, d’interroger les professionnel·le·s, les familles et les jeunes eux-mêmes. Une formation destinée aux professionnel·le·s a également pu être observée.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les groupes d’entraînement aux habiletés sociales observés s’appuient sur des approches théoriques relativement similaires, mais diversement traduites en pratiques selon les espaces et les professionnel·le·s impliqués. Les différentes modalités du travail sur les habiletés sociales reflètent des enjeux de positionnements mutuels dans le champ de l’autisme, liés à la plus ou moins grande centralité des acteurs dans ce champ, avec cependant l’impression partagée par ces acteurs que les GEHS constituent un accompagnement innovant et efficace, et qu’ils représentent une alternative sérieuse à d’autres modalités de prise en charge délégitimées (approches psychanalytiques, ou méthodes comportementales jugées trop limitantes).
La recherche permet en outre de mettre au jour les attentes sociales véhiculées dans les groupes, via le travail systématique de certaines dimensions semblant constituer le cœur de ces pratiques d’accompagnement (les émotions, le rapport à la scolarité ou à la vie professionnelle). Certains aspects des habiletés sociales semblent plus discutés, ou diversement appropriés alors même qu’ils semblent importants dans les interactions observées, à l’image des questions de genre et de sexualité. Cette analyse de la thématisation des habiletés sociales permet de dessiner les attentes sociales minimales d’une autonomie des personnes autistes au sortir de l’adolescence, et questionne la conceptualisation même des normes sociales, la plupart du temps pensées dans une optique d’intégration sociale dans le système scolaire ou productif, et sur la base d’une approche contractuelle et individualisante des relations sociales.
APPORTS OU IMPACTS POTENTIELS
Sans prétention à transformer les pratiques, ni à la prescription de politiques d’accompagnement, cette recherche invite à saisir les contours d’un type d’accompagnement de l’autisme, en prenant conscience des enjeux propres au champ de l’autisme, à ses professionnel·le·s et à ses publics.
Equipes du projet
Coordonnateur :
VUATTOUX Arthur
N° ORCID : 0000-0002-1722-5383
Structure administrative de rattachement : Inserm
Laboratoire ou équipe : Institut de Recherche Interdisciplinaires sur les enjeux sociaux(IRIS), CNRS UMR 8156, Inserm U997, EHESS, Université Paris 13
Autres équipes participantes :
Responsable de l'équipe 2 : DAMAMME Aurélie
CRESPPA UMR 7217, Équipe GTM
Dites-le nous !