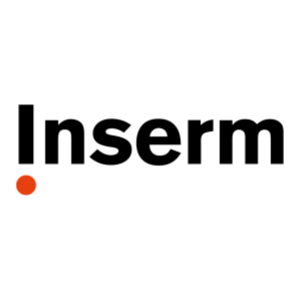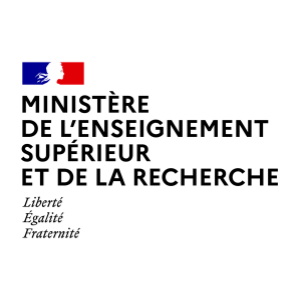Impact d’une concertation entre médecin coordonnateur et médecin traitant sur l’optimisation de la prescription médicamenteuse de la personne entrant en EHPAD et la diminution des hospitalisations (OPTIM EHPAD) – Philippe MICHEL
Résumé de soumission
Contexte : En EHPAD, les résidents ont en moyenne 7 à 8 traitements avec un défaut d’optimisation des prescriptions, 50 à 70% des résidents ayant au moins une prescription inappropriée. Ce défaut d’optimisation est associé à une augmentation des évènements indésirables médicamenteux, des hospitalisations et de la mortalité. L’entrée en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) constitue l’opportunité d’une concertation entre le médecin coordonnateur de l’EHPAD (MCO) et le médecin traitant (MT) sur la prescription médicamenteuse. Les études montrent qu’il est nécessaire d’apporter des outils d’aide à l’optimisation des prescriptions.
Objectifs : L’objectif principal est d’évaluer l’impact d’une intervention visant à inciter et faciliter l’optimisation de la prise en charge médicamenteuse de la personne entrant en EHPAD, fondé sur une décision à l’issue d’une concertation entre le MT et le MCO, aidée d’un outil développé spécifiquement (outil OPTIM-EHPAD), sur le nombre de journées d’hospitalisation toute cause par résident dans les 6 mois suivant l’entrée en EHPAD.
Les objectifs secondaires sont d’évaluer l’impact de l’intervention sur les passages aux urgences et sur les alertes iatrogéniques, et de décrire les modalités d’implémentation de l’intervention.
Nous évaluerons également les facteurs, en particulier de type organisationnel, qui facilitent ou qui freinent l’appropriation d’OPTIM EHPAD par les acteurs. Il s’agit également d’apprécier des conditions de la transposabilité d’OPTIM EHPAD et d’apporter des éléments de compréhension généraux sur les difficultés rencontrées par les acteurs en matière de coordination de la prise en charge.
Méthodes : Type d’étude :
Etude interventionnelle, randomisée en clusters, de type stepped wedge, un cluster comprenant plusieurs EHPAD. Les résidents seront inclus à leur entrée en EHPAD. Le nombre de sujets à inclure est de 2 000 résidants, soit 4 clusters de 25 MCO (4 patients par MCO par trimestre). Le suivi du résident sera longitudinal, à partir de la date d’inclusion et pendant les 6 mois suivant son entrée, ou à défaut jusqu’à sa date de sortie définitive d’EHPAD ou son décès.
Une étude qualitative sera conduite, par entretiens et questionnaires, auprès des MCO, des MT, des infirmiers, des directeurs d’EHPAD, des familles et des résidents.
Intervention :
L’intervention d’optimisation de la prescription comprendra une concertation entre le MCO d’EHPAD et le MT, à l’aide d’un outil d’optimisation de la prescription comme support structurant de la révision des traitements lors de la concertation.
Source des données :
Les données seront issues des dossiers médicaux des résidents et de la base du Système national des données de santé (SNDS) (pour les hospitalisations et les consommations médicamenteuses).
Perspectives :
– Diffuser au plan national des outils-supports efficaces et efficients pour optimiser la prise en charge médicamenteuse des résidents âgés d’EHPAD ;
– Faire des préconisations pour la relation MCO-MT et le rôle du MCO ;
Synthèse finale du projet
1. Contexte et objectifs du projet
- Contexte
En EHPAD, les résidents ont en moyenne 7 traitements avec un défaut d’optimisation des prescriptions, 50 à 70% des résidents ayant au moins une prescription non optimale. Ce défaut d’optimisation est associé à une augmentation des évènements indésirables médicamenteux, des hospitalisations et de la mortalité.
Le taux d’hospitalisation des résidents en EHPAD est de 40 %, pour en moyenne 19 jours d’hospitalisation par an. Beaucoup de ces hospitalisations sont potentiellement évitables, entre 19 et 67 % selon les études. Le défaut d’optimisation des prescriptions médicamenteuses en EHPAD se traduit par le manque de traitement (underuse), la surconsommation (overuse) et la survenue d’erreurs médicamenteuses à l’origine d’évènements indésirables médicamenteux dont certains conduisent à des hospitalisations évitables, impactant par ses conséquences l’autonomie et la qualité de vie des 600 000 personnes âgées résidant en EHPAD en France.
Un outil d’optimisation de la prise en charge diagnostique et médicamenteuse, appelé OPTIM-EHPAD, adapté aux problématiques de santé gériatriques et aux pratiques professionnelles spécifiques en EHPAD a été élaboré. Il est fondé sur une décision issue d’une concertation entre le médecin traitant (MT) et le médecin coordonnateur d’EHPAD (MCO) qui impacterait sur :
- le processus de prise en charge des résidents,
- les résultats de prise en charge des résidents,
- La communication et la coordination entre le médecin coordonnateur et le médecin
b) Objectifs
Objectifs de l’étude quantitative
Objectifs principaux
Les objectifs principaux de l’étude, analysés selon une approche séquentielle hiérarchique, sont d’évaluer l’impact d’une intervention visant à inciter et faciliter l’optimisation de la prise en charge diagnostique et médicamenteuse de la personne entrant en EHPAD, fondé sur une décision à l’issue d’une concertation entre le MT et le MCO :
- sur la présence d’au moins une prescription potentiellement inappropriée (PPI) pour chaque résident durant les mois M3 à M6 suivant l’entrée en EHPAD
- sur les hospitalisations toute cause par résident dans les 6 mois suivant l’entrée en EHPAD
Objectifs secondaires
En termes d’impact pour les résidents : évaluer l’impact de l’intervention :
- sur le nombre moyen de PPI par résident durant les mois M3 à M6 suivant l’entrée en EHPAD
- sur le nombre d’aller-retours aux urgences (sans hospitalisation) par résident dans les 6 mois suivant l’entrée en EHPAD.
- sur les hospitalisations toute cause par résident dans les 3 à 6 mois suivant l’entrée en EHPAD
En termes de faisabilité :
- De décrire les modalités de déploiement de l’intervention.
Objectifs de l’étude qualitative
L’objectif de l’enquête qualitative est de contribuer à une meilleure compréhension des facteurs, en particulier de type organisationnel, qui facilitent ou qui freinent l’appropriation d’OPTIM- EHPAD par les acteurs. Cette enquête doit donc constituer un élément-clé d’appréciation des
conditions de la transposabilité d’OPTIM-EHPAD dans un autre contexte que celui de l’étude d’évaluation. Elle doit aussi fournir des éléments d’accompagnement à la conception d’une stratégie de changement pour déployer plus largement OPTIM-EHPAD.
De manière secondaire, l’étude qualitative apportera des éléments de compréhension généraux sur les difficultés rencontrées par les acteurs en matière de prise en charge diagnostique et médicamenteuse dans les EHPAD, et notamment pour ce qui concerne la coordination de la prise en charge.
2. Méthodologie utilisée
Initialement, il s’agissait d’une étude interventionnelle, randomisée en clusters, de type stepped wedge (implémentation séquentielle de l’intervention tous les 4 mois dans 4 groupes de clusters), le cluster étant le MCO. Les regroupements de MCO ont été définis selon la zone géographique de leur EHPAD. Il était prévu que :
- Les résidents entrant en EHPAD pendant la période d’inclusion pré interventionnelle (groupe contrôle) soient pris en charge comme habituellement dans l’EHPAD
- Les résidents entrant en EHPAD pendant la période d’inclusion post interventionnelle (groupe intervention) aient l’optimisation de leur prise en charge diagnostique et médicamenteuse, à l’issue d’une concertation entre le MT et le MCO fondée sur l’outil OPTIM-
Population des médecins coordonnateurs (MCO):
Tout médecin coordonnateur d’EHPAD ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la caisse pivot est le régime général et dont la direction a donné son accord pour sa participation à l’étude.
Population des résidents :
Tout nouveau résident entrant dans un EHPAD participant après exclusion des résidents n’ayant pas de MT déclaré à leur entrée en EHPAD.
Intervention
Le principe de cette étude est de proposer aux MCO une démarche concrète pour favoriser la coopération avec les MT. Cette démarche consiste à réaliser des concertations thérapeutiques entre MCO et MT, en s’appuyant sur un support adapté, dans le mois suivant l’entrée d’un nouveau résident en EHPAD
Les dates d’implémentation de l’intervention dans chacun des 4 groupes étaient les suivantes : le 1/06/2019 pour le groupe 1, le 1 er octobre 2019 pour le groupe 2, le 1er février 2020 pour le groupe 3 et le 2 juillet 2020 pour le groupe 4.
Les médecins coordonnateurs des EHPAD ont été formés une demi-journée sur l’outil OPTIM- EHPAD. L’outil OPTIM-EHPAD est un outil pédagogique mettant à la disposition des médecins une méthodologie rigoureuse de révision des diagnostics et la prescription par étapes chronologiques, associée à des mémos, constituant une forme de chemin clinique pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prescription chez les résidents en EHPAD à l’issue d’une concertation entre le MT et le MCO.
. Analyse quantitative
Au vu du faible nombre d’inclusions, des analyses uniquement descriptives ont été réalisées sans extraction des bases de l’Assurance Maladie dont l’exploitation complexe n’aurait pas permis de répondre statistiquement aux objectifs initiaux du projet. Seules les données de la période interventionnelle sont disponibles.
Analyse qualitative
Les MCO ont été sollicités pour des entretiens concernant leur expérience de l’intervention OPTIM-EHPAD après une durée de 3 à 9 mois selon les groupes, théoriquement suffisante pour la mettre en œuvre. Tous les MCO participant à l’étude étaient éligibles, qu’ils soient parvenus ou non à réaliser des concertations. A l’issue des entretiens, ils étaient invités à fournir les
coordonnées de tous les MT s’étant concertés avec eux ou ayant refusé de le faire, afin de les interroger à leur tour. Étaient donc seulement éligibles les MT concernés par l’intervention, c’est- à-dire dont au moins un patient avait intégré un EHPAD participant au cours de la période d’inclusion, ou ayant commencé à suivre au moins un résident d’un tel EHPAD immédiatement après son entrée.
Il était prévu d’interroger une trentaine de MCO et une dizaine de MCO au sujet de leur contexte d’activité, de leur attitude et de leurs pratiques habituelles envers l’iatrogénie médicamenteuse, du déroulement concret de l’intervention OPTIM-EHPAD et de leur avis sur celle-ci. Les entretiens ont été réalisés par un post-doctorant en sociologie avec les MCO et deux internes de médecine générale avec les MT. Ils ont été systématiquement enregistrés et retranscrits. Ils ont ensuite été analysés sans perspective théorique particulière, selon une démarche inductive orientée exclusivement par les objectifs de l’étude.
3. Principaux résultats obtenus
Il s’est avéré impossible de réaliser autant de concertations que prévu, malgré tous les efforts pour accompagner les MCO : formations, relances téléphoniques, saisie des données, newsletters. Sur les 1000 concertations attendues, seulement 183 ont été réalisées, par 25 MCO sur les 62 volontaires initiaux formés sur les 4 groupes.
Les effectifs sont trop faibles pour mesurer les effets des concertations sur les variables d’intérêt, et déterminer si elles ont entraîné des améliorations objectives de l’état de santé des résidents concernés. Les données quantitatives montrent cependant que les concertations ont abouti à des modifications substantives de leurs ordonnances :
- Concernant les alertes iatrogéniques : 59 % des concertations ont permis d’en constater au moins une, et 28,4 % ont conduit à en lever au moins une.
- Concernant l’ajout de traitements : 30,6 % des concertations ont conduit à ajouter au moins une nouvelle molécule, et 67,8 % au moins un nouveau vaccin.
- Concernant la suppression de traitements : 36.6 % des concertations ont conduit à supprimer au moins une molécule.
- Concernant l’adaptation des traitements : 7.1 % des concertations ont abouti à la substitution d’au moins une molécule, 25.7 % à des changements de posologie et 2.2 % à des changements de forme galénique.
- Concernant les critères de suivi : 53,6 % des concertations ont conduit à en retenir au moins un afin de prévenir l’iatrogénie.
Au total, seulement 21,3 % des concertations n’ont abouti à aucun changement.
Les données qualitatives apportent des informations de nature différente et complémentaires. Les MCO décrivaient des adaptations modestes plutôt que des changements radicaux. Ils n’en n’espéraient pas de réduction significative du risque iatrogénique, qu’ils jugeaient globalement maîtrisé dans leurs établissements. De surcroît, ils contestaient la responsabilité des concertations dans ces changements, considérant qu’ils concernent des problèmes qu’ils auraient détectés et corrigés de toute façon. Ce sont essentiellement leurs pratiques relatives à la vaccination que le dispositif OPTIM-EHPAD aurait améliorées.
Les entretiens ont de surcroît révélé que beaucoup de concertations se sont déroulées de manière expéditive et superficielle, avec des MT se contentant d’approuver les suggestions des MCO, sans chercher à les comprendre ni à les discuter.
Les témoignages des MCO font ressortir deux difficultés principales :
- L’épidémie de COVID, qui s’est répandue en France alors que les EHPAD du second cluster devenaient opérationnels, tandis que ceux du troisième cluster démarraient à peine l’intervention. Elle a conduit à la fermeture totale des EHPAD, à la suspension des admissions mais aussi des visites des MT, ainsi qu’à l’accaparement des MCO par la gestion de crise.
- L’indisponibilité ou le manque de confiance des
Malgré leur absence de bénéfice évident sur la santé des résidents, la plupart des MCO jugeaient favorablement les concertations. Ils reconnaissaient qu’ils ne possédaient pas de méthode pour analyser les traitements des résidents, les conduisant parfois à se sentir dépassés devant les ordonnances les plus longues. Ils ont apprécié l’approche exhaustive et systématique imposée par le support, consistant à évaluer successivement tous les traitements en retrouvant leurs indications et en les confrontant aux recommandations. Elle les a incités à reconstituer les dossiers médicaux des résidents de manière plus volontariste, en recherchant des informations qu’ils renonçaient souvent à obtenir, notamment en raison du temps nécessaire. De même, ils ont salué l’intérêt d’échanger avec les MT face aux cas difficiles.
Les entretiens avec les MT se sont avérés peu informatifs, en raison du faible nombre et de l’ancienneté de concertations auxquelles ils avaient participé. Ils ne seront donc pas analysés ici.
4. Apports en termes d’action de santé publique : préconisations à court terme
Ces résultats ne plaident pas pour la généralisation de l’intervention OPTIM-EHPAD telle qu’elle était proposée, dont la mise en œuvre s’est avèrée trop dépendante des contextes organisationnels, et l’efficacité trop incertaine. Ils invitent plutôt :
- À mettre à disposition un outil d’optimisation des diagnostics et thérapeutiques, à former tous les professionnels à son utilisation et à élaborer localement un protocole d’utilisation adapté à la situation. Par exemple, usage systématique par le MCO qui ne sollicite le MT, le pharmacien ou le cadre de santé qu’en cas de situation complexe (modèle de la concertation pluriprofessionnelle).
- À impliquer davantage les infirmières d’EHPAD dans la détection des situations iatrogènes, en s’appuyant sur les formations à la pratique avancée, afin de suppléer les MCO et d’offrir un premier niveau d’alerte sur les prescriptions délivrées aux résidents.
- À réviser périodiquement les ordonnances des résidents et non pas seulement au moment de l’entrée, pour favoriser la réévaluation régulière de leurs traitements.
- À informatiser le support d’optimisation diagnostique et thérapeutique et à le diffuser largement auprès des médecins suivant des patients âgés, qu’ils résident ou non en EHPAD, afin de faciliter leur appréhension des cas gériatriques complexes.
5. Impacts à moyen terme de ces résultats : Propositions pour un modèle semi libéral des EHPAD
L’efficacité du modèle actuel suppose plusieurs conditions, expliquant pourquoi peu d’EHPAD parviennent à l’appliquer spontanément. Les difficultés peuvent être ainsi résumées : Les MT, même appétents aux sujets de gériatrie, n’ont pas le temps nécessaire à ces démarches du fait d’un mode d’exercice éclaté entre plusieurs EHPAD, Pour promouvoir une organisation efficace du travail des MT en EHPAD, le suivi d’un nombre substantiel de résidents et des visites régulières, avec un accompagnement du personnel soignant apparait nécessaire. Cette organisation s’avère propice à la sécurité des soins en favorisant l’implication des MT dans la vie des EHPAD et le développement de rapports constructifs avec les MCO. Un modèle d’incitation, voire de nature financière, pour les généralistes acceptant de suivre au moins 10 résidents d’un même EHPAD et de s’y rendre une fois par semaine, sur un créneau organisé pour l’ensemble des patients, pourrait être proposé.
Ce modèle présente l’avantage de garantir la continuité des soins lors des congés d’un des MT ou du MCO, le modèle reposant alors sur plusieurs médecins (versus un unique médecin salarié). Les EHPAD, pour leur part, doivent posséder des équipes suffisamment stables, compétentes et motivées pour accompagner correctement les MT. Ceci est loin d’être acquis dans un contexte où le manque de soignants et la pénibilité des conditions de travail dans les EHPAD engendrent des difficultés de recrutement et un turn-over significatif, d’ailleurs loin d’épargner les MCO. Cela signifie que la plurirofessionnalité doit être favorisée, de telle sorte que la sécurité des soins ne
repose pas que sur un professionnel : l’équipe responsable de la sécurité médicamenteuse est par essence composée de médecins, pharmaciens et infirmiers.
L’ampleur de ces difficultés signifie que le développement du modèle semi-libéral pourrait être une réponse envisageable.
- Des contrats assortissant les obligations faites aux MT d’obligations symétriques faites aux EHPAD : les MT s’engagent à suivre un nombre minimal de résidents, à se rendre toutes les semaines à l’EHPAD et à participer aux commissions gériatriques ; les EHPAD s’engagent à préparer et à accompagner leurs visites, ainsi qu’à mettre en œuvre les mesures de suivi nécessaires. Des incitations financières pour les MT et les EHPAD signant de tels contrats, valorisant l’engagement des MT dans la vie des établissements, et permettant aux seconds de financer du temps d’IDE dédié à l’accompagnement des
- L’implication des pharmaciens d’officine pour les EHPAD sans PUI au travers des outils numérisés régionaux
- Une clarification du statut juridique des EHPAD, considérés comme des substituts du domicile où les résidents conservent le libre choix de leur MT. Le modèle semi-libéral implique de restreindre cette liberté, ce qui survient déjà souvent en pratique mais s’oppose au code de déontologie médicale.
Equipes du projet
Coordonnateur :
MICHEL Philippe
N° ORCID : 0000-0001-8455-8332
Structure administrative de rattachement : Université Claude Bernard Lyon 1 Hospices Civils de Lyon
Laboratoire ou équipe : Laboratoire Health Services and Performance Research (HESPER EA 7425)
Autres équipes participantes :
Responsable de l'équipe 2 : JEANDEL Claude
Centre Antonin Balmès, CHU de Montpellier
Responsable de l'équipe 3 : CASTEL Patrick
Centre de Sociologie des Organisations (Sciences Po, CNRS, UMR7116)
Dites-le nous !