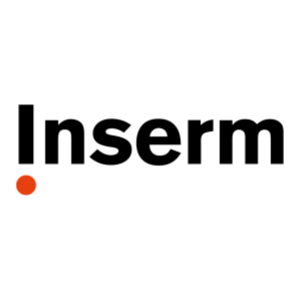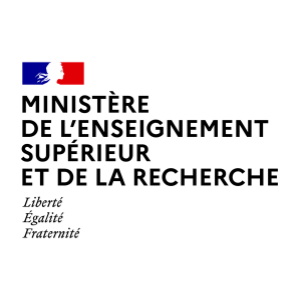L’ordre négocié de l’alcool au rugby et en escalade (ONARES) – Yannick Le Hénaff
Résumé de soumission
Si le sport est a priori considéré comme un facteur protecteur des consommations de psychotropes (Palmer, 2020), plusieurs études révèlent au contraire une consommation de drogues accrue chez les sportifs, en particulier d’alcool (Lorente, et al, 2003 ; Peretti-Watel et al., 2003), ce que confirme une de nos enquêtes récentes (Le Hénaff et al., 2019). Mais alors que la plupart des recherches s’intéressent aux pratiques de consommations des sportifs, nous avons fait l’hypothèse du rôle central des dirigeants et des entraineurs dans le cadre de ces pratiques. Ces derniers semblent en effet cernés par des injonctions contradictoires : favoriser la performance (et donc l’hygiène de vie) tout en encourageant les pratiques festives, présentées comme des rouages essentiels de la cohésion. Il s’agissait donc, en investissant cette nouvelle recherche, d’analyser les processus de production et de régulation des pratiques de consommation d’alcool au sein des clubs sportifs, en se focalisant sur les entraîneurs et les dirigeants. Leurs pratiques ordinaires de travail et relations avec les joueurs, et plus largement avec les protagonistes du club ont ainsi été analysées afin de comprendre en quoi ils contribuent, de façon inattendue ou parfois contradictoire, à réguler des pratiques sociales en matière d’alcool.
Méthodologies
Le monde du rugby a été considéré comme un monde pertinent à questionner dans ce cadre pour trois raisons : d’abord de l’intérêt qu’ils suscitent auprès des alcooliers, vecteur publicitaire privilégié (Bonnet, 2020) ; les consommations importantes identifiées, comparativement à d’autres sports (Le Hénaff et al., 2019). Enfin car cette pratique permet d’analyser le poids et les contours des masculinités hégémoniques, dont nous avons fait
l’hypothèse qu’elles prenaient des formes singulières (Galy, Mennesson, 2022). Des logiques de différenciation subtiles sont à l’œuvre qui se déclinent selon des formes viriles diverses, et qui prend ici la forme de « l’entrepreneur festif ». Nous avons alors décidé de nous centrer sur le fonctionnement des clubs à l’échelle locale. L’enquête repose sur l’analyse de quarante-cinq entretiens dans trois clubs amateurs. Nous avons été guidés par un principe de diversification des terrains d’enquête, bien d’avantage que de comparaison stricto sensu. Des dirigeants, entraineurs ainsi que les acteurs les plus actifs en matière de festivités ont été rencontrés (bénévoles s’occupant de la gestion de la buvette, des commandes, des relations avec les partenaires, etc.). Ces données ont été
complétées par des observations, lors de fêtes particulières ou des jours de match, et même dans le quotidien de ces clubs.
Nous déployons nos résultats selon trois axes. Dans une première partie, nous nous intéressons à ce qui rend possible ces fêtes, et notamment au travail de confinement (qui les rend moins visible du grand public) et aux différents dispositifs encourageant ces pratiques festives. Puis, nous nous analysons le travail relationnel et affectif des dirigeants pour encourager ces festivités. Enfin, notre regard se porte sur les attentes visant à faire des joueurs des participants actifs à ces festivités, mais plus encore des organisateurs de celles-ci.
Confiner et inciter aux pratiques festives.
Les clubs enquêtés mettent à disposition des joueurs et des bénévoles un cadre susceptible d’encourager les festivités. Ce rôle est d’abord joué par le club house, qualifié de « lieu de vie » par ses membres, ayant un rôle la construction des collectifs. Il se présente comme un dispositif d’attachement au club, garant des formes de cohésion et espace de rencontre. Ce clubhouse est aussi un rouage essentiel dans ce que nous nommons le travail de confinement des espaces et des temps festifs – et donc d’encadrement -, qui contribue à invisibiliser certaines de ces pratiques, et donc à les rendre possible. Et en particulier celles qui sont difficilement tolérées hors du monde du rugby. La nudité, les violences verbales et parfois sexistes, les chants et plus largement le bruit, constitutifs de ces groupes masculins, engendrent ainsi régulièrement des troubles et des tensions quand le groupe est confronté à l’extérieur, comme dans les bus ou les trains lors des retours de match.
Les transgressions ne sont autorisées qu’à la condition de leur invisibilisation. Par exemple, les éducateurs se soucient de l’absence des parents de joueurs mineurs lors de déplacements en bus, pour laisser libre cours aux chants paillards ou à des formes de nudité. Ce confinement des pratiques festives viriles est la condition de leur perpétuation au sein d’un entre-soi exclusivement masculin ou presque. En d’autres termes, ces pratiques sont largement encouragées tant qu’elles ne sont pas perceptibles à l’extérieur, et donc quand elles n’abîment l’identité collective du club (Goffman, 1974).
Ce confinement facilite l’affranchissement de certaines normes et autorise une licence festive élargie, qui ne s’appuie pas seulement sur l’exclusion des étrangers au club, mais aussi sur la mise en retrait des dirigeants et entraîneurs qui s’éclipsent au cours de la soirée. C’est dans cette même perspective que sont valorisés les espaces de tolérances à leurs pratiques festives, soit les établissements les plus tolérants (le « bar du club »). Confinées de la sorte, ces pratiques festives peuvent se développer sans entrer en tension avec des normes de retenue attendues dans d’autres espaces sociaux.
Si cette privatisation des espaces encourage, selon toute vraisemblance, les excès, des dispositifs incitent également les joueurs à participer aux fêtes et rendent possible les consommations d’alcool. Le premier d’entre eux est la valorisation du don, inscrivant ces consommations d’alcool dans les sociabilités quotidiennes des clubs, au point d’irriguer de nombreuses interactions. Elles marquent l’accueil des dirigeants des équipes adverses lors du repas d’avant-match, ou à la fin du match de celui-ci, mais prennent également place lors des rencontres avec les sponsors et les différents partenaires.
Le « système des tournées » (Weber, 2001) est, dans ce cadre, valorisé. Tout comme l’analyse Nicolas Renahy au sujet des pots organisés dans un club de foot amateur, la tournée ne relève « pas tant d’un don personnalisé visant à créer une situation de réciprocité vis-à-vis de tel ou tel individu que d’un don au groupe, qui permet de s’y rattacher tout en assurant sa participation effective à la sociabilité ainsi perpétuée » (2010, p.89). La consommation n’a donc pas seulement une signification sociale, elle est aussi soumise à des normes contraignantes (Perrin-Hérédia, Ducourant, 2019, p.135).
Comme Merle et Le Beau (2004) le soulignaient, les agents et cadres de la Poste ne boivent pas seuls en raison de l’organisation du travail, qui impose une vie collective. C’est également le cas pour le rugby où les consommations sont collectives.
Des dirigeants dans les fêtes : l’analyse du travail relationnel
Un important travail relationnel et affectif (Mears, 2015) est observable parmi les dirigeants afin que les joueurs s’impliquent auprès de leurs coéquipiers et pour le club à travers des festivités. La plupart des dirigeants et entraîneurs se vivent ainsi comme les garants de cette cohésion, et parmi les principaux acteurs. Ils s’imposent ici d’y participer tout en s’en retirant
afin de préserver des moments uniquement dédiés aux joueurs, entre eux pour construire leurs liens de solidarité loin des regards de l’autorité dirigeante.
Les entraineurs et dirigeants sont, dans ce cadre, d’importants prescripteurs de festivités auprès des joueurs. On qualifie de « casaniers » ceux qui ne restent pas avec l’équipe après les matchs ou entrainements et ils se « font vanner ». L’usage de l’humour dénote un partage et une réaffirmation de normes entre entraineurs et joueurs (Frisch-Gauthier, 1961 ; Damont & Pégard, 2017). Ce travail relationnel, qui prend également forme lors des festivités, tend également à façonner les significations données à ces moments, mais aussi aux effets psychotropiques des consommations (Selponi, 2019).
La gestion du bar permet – tâche uniquement allouée aux dirigeants -, dans une certaine mesure et jusqu’à ce qu’ils quittent les lieux, de garder un œil sur les consommations et les catégories d’alcool proposées. C’est dans cette même perspective que les dirigeants sont attachés à garder la main sur les lieux de stockage des futs ou des bouteilles d’alcool, qui restent tus ou mis sous clés. C’est ainsi la bière qui est essentiellement proposée dans ces espaces, et qui n’est à ce titre jamais problématisée. De la sorte, ces dirigeants participent à la construction sociale des effets de ces psychotropes (Selponi, 2019), mais aussi de leurs risques. La bière, largement disponible est considérée comme un produit fédérateur, par opposition aux « alcools forts » distribués avec parcimonie et jugés vecteurs de problèmes.
Pour tous les enquêtés, ces moments festifs sont d’une importance capitale, favorisant la connaissance des joueurs, leur rapprochement, et même la performance sportive. Les fêtes sont perçues par les dirigeants et entraineurs comme des modes de socialisation propices à la constitution de solidarités et de prises de risques sur le terrain. Les dirigeants peuvent ainsi fermer les yeux sur certaines pratiques de transgressions et d’alcoolisation au prétexte
qu’elles participent de la construction d’un collectif sportif ; voire se réjouissent de la démonstration de ces « conneries » dès lors qu’elles sont collectives. Ces pratiques festives peuvent être appréhendées comme des collective rituals of confidence building, soit des pratiques collectives homosociales et ritualisées, dispositifs de mobilisation des masculinités autant que de construction de la confiance (Grazian, 2007).
S’engager dans un travail d’encadrement des consommations d’alcool, et plus largement des festivités, s’avère complexe dans ce monde social. D’abord car ces pratiques festives relèvent de la norme, et les interventions sont vectrices de tension. Et c’est également à cette aune qu’il faut considérer la mise en retrait des dirigeants au fur et à mesure que les fêtes se poursuivent dans la nuit. Ce retrait des espaces festifs leur permet de ne pas perdre
la face en cas d’inconduites des joueurs. Ils participent ainsi largement à ces « transgressions réglées » (Pialoux, 1992, 101) : l’évitement de situations (Goffman, 1974) où les écarts seraient trop évidents et visibles est ainsi un principe de figuration largement répandu dans ce monde social. Ce premier principe de figuration prend la forme de l’inattention calculée (Goffman, 1974), que l’on observe également lorsque ces dirigeants ferment les yeux face à la présence d’alcool, fort notamment, lors des stages, ou chez les catégories plus jeunes.
Face à cette difficulté à intervenir, les relations à la plaisanterie sont largement mobilisées.
Elles permettent de marquer la faute (un jour étant sorti la veille d’un match par exemple), de signaler au joueur que l’on n’est pas dupe. La chambre, forme d’humour largement partagée dans ce monde social, permet ainsi de signaler que l’on a vu sans formellement sanctionner.
Produire des entrepreneurs festifs
Il n’est pas seulement attendu des joueurs qu’ils participent aux festivités, mais également qu’ils participent à leur organisation, selon des formes de masculinité dont nous proposons ici de dessiner les contours et que nous regroupons sous l’expression « d’entrepreneurs festifs ».
Ces pratiques festives sont d’abord conditionnées à un impératif dont rend compte une expression leitmotiv de ce monde : « il faut assumer », injonction qui définit en grande partie les limites de ce qui est toléré lors de ces festivités. Cette formule rend compte de la nécessité d’être présent – c’est-à-dire de participer au match –, mais aussi et surtout de « s’engager » selon les critères d’investissement corporel viril de ce monde. Les sorties festives sont tolérées (y compris les veilles de match) sous la condition d’« assumer » : les douleurs physiques, la fatigue et l’état de santé dégradé, et donc les risques de blessure. Ici comme dans les virilités populaires, on dénonce celui qui s’écoute trop (Boltanski, 1970 ; Teboul, 2015), et les festivités peuvent même s’apparenter à un apprentissage de la gestion et du dépassement des douleurs corporelles.
Cet ethos sportif et viriliste particulier s’imprègne dans les corps, mais participe plus largement d’attentes qui vont au-delà de la participation aux festivités ; il est également attendu des joueurs qu’ils organisent eux-mêmes des festivités. Dans les trois associations, le club house est régulièrement prêté aux joueurs pour des dîners, des anniversaires ou des festivités diverses, et des fûts ou des bouteilles de vin leur sont régulièrement offerts à ces occasions.
L’organisation de ces festivités entre joueurs est rendue possible par la mise en place d’une Amicale des joueurs ou d’une cagnotte, qui participe d’une économie locale de la fête au sein des clubs. Pour récolter des fonds, les joueurs sont encouragés à organiser des évènements tout au long de l’année. Ils s’exercent ainsi à la pratique de la comptabilité, de la logistique ou encore de la vente, ce qui traduit finalement l’apprentissage d’un « sérieux
managérial » (Abraham, 2007). Les compétences festives se traduisent aussi par la maitrise des « débordements ». Il y a un travail de responsabilisation des joueurs : apprendre à laisser propre le club house, assurer la sécurité autour du bar ou encore savoir tenir une buvette à l’extérieur. Cette éducation à l’entreprenariat fait écho à d’autres recherches, pointant les proximités fortes entre cercles économiques locaux et clubs de rugby (Augustin, Garrigou, 1985 ; Basson, 2018).
Outre les soutiens matériels, ces encouragements à investir les organisations festives se traduisent par des discours valorisant les « leaders festifs », capables de créer la cohésion de groupe en participant activement ou organisant des soirées. Ces « leaders » témoignent à leur manière, de l’idéal des valeurs associatives sportives (Falcoz, Walter, 2009). En faisant de la solidarité et des fêtes un enjeu, les dispositions festives peuvent se convertir en ressource pour ces sportifs consacrés, sur le marché des joueurs, mais aussi sur le marché de l’emploi local.
Conclusion
Le monde du rugby soulève un paradoxe promotionnant tout à la fois les pratiques festives, et notamment de consommation d’alcool, et la performance sportive.
Force est de constater que dans ce fief de la masculinité, les pratiques de consommation irriguent largement les relations quotidiennes, et participent de ces sociabilités. Et c’est d’ailleurs sur la revendication de la «convivialité » – le terme a traversé notre recherche – que se justifient en grande partie ces pratiques festives. Convivialité nécessaire à la fois pour construire l’attachement au club mais également pour construire les solidarités, entre joueurs en particulier. Imprégnés d’idéaux virils, ces moments festifs, largement encouragés, sont également des espaces propices à l’excès. Loin de constituer une faute, ceux-ci, à condition d’impliquer le collectif, sont même valorisés car terreau de l’identité. Les pratiques les plus transgressives sont d’ailleurs rendues possible par un travail de confinement géographique (il s’agit de faire la fête loin des regards) et de valorisation de l’entre-soi (écartant les étrangers à la pratique).
Ces pratiques de consommation prennent sens dans le cadre d’une masculinité que nous avons tenté de caractériser, valorisant notamment à valoriser la figure de l’entrepreneur festif.
Ces joueurs peuvent alors faire de leurs dispositions festives une ressource, à la fois sur le marché du travail sportif (certains joueurs étant rétribués financièrement), mais aussi sur le marché du travail tout court.
Notre recherche soulève deux leviers pour l’aide à la décision pour l’action publique dans le cadre de la sensibilisation aux pratiques de consommation d’alcool. Elle invite d’abord à considérer la question des consommations d’alcool non seulement au prisme de la jeunesse – et par les risques comme c’est le plus souvent proposé – mais aussi à la lumière des questions de genre. Cette sensibilisation aux pratiques de consommation peut ensuite être appréhendée à l’échelle des organisations (sportives), et notamment des dirigeants et entraîneurs.
Synthèse finale du projet
Productions scientifiques et communications (Liste non exhaustive)
Direction de numéro/ouvrage
- Boubal C., Le Hénaff Y., Produire et réguler les fêtes, Terrains & Travaux,
https://tt.hypotheses.org/645 (proposition de numéro spécial acceptée, à paraître en 2023 – l’appel à contribution prend fin en février 2023) - Le Hénaff Y., Bonnet C., Feliu F., Spach M., (2020) (dir.), Penser l’alcool au cœur des sciences sociales, Presses Universitaires de Nanterre, Coll. « Le social et le politique ».
Articles
- Palmer C., Le Hénaff Y., Feliu F., Bonnet C., (2020, online first; 2021 version
papier), Drinking stories among climbers and older athletes in France and Australia,
International Journal for Sociology of Leisure, Pour un numéro spécial Leisure and Alcohol, 4/1, p.7-24, DOI: 10.1007/s41978-020-00058-z - Boubal C., Le Hénaff Y., (soumission prévue tout début 2023), Produire des
masculinités festives: le cas du rugby amateur. La revue est encore en discussion entre les auteur.es.
Chapitres d’ouvrage
- Le Hénaff Y., Bonnet C., Feliu F., Spach M., (2020), Conclusion, in Le Hénaff Y.,
Bonnet C., Feliu F., Spach M., (dir.), Penser l’alcool au cœur des sciences sociales, p.8-21, Presses Universitaires de Nanterre, Coll. « Le social et le politique ». - Le Hénaff Y., Bonnet C., Feliu F., Spach M., (2020), Introduction : L’alcool à
l’épreuve des sciences sociales, in Le Hénaff Y., Bonnet C., Feliu F., Spach M., (dir.), Penser l’alcool au cœur des sciences sociales, p.255-261, Presses Universitaires de Nanterre, Coll. « Le social et le politique ».
Traduction
- Alcool et addiction dans le sport : des relations troubles, de Catherine Palmer, in Le Hénaff Y., Bonnet C., Feliu F., Spach M., (à paraître en novembre 2020) (dir.), Penser l’alcool au cœur des sciences sociales, p.138-15, Presses Universitaires de Nanterre, Coll. « Le social et le politique », p.203-228.
Communications
- Boubal C., Le Hénaff Y., Organiser les consommations d’alcool au club : le cas du
rugby, Montpellier, décembre 2022 - Boubal C., Le Hénaff Y., Bonnet C., Feliu F., 2022, Investir un discours de prévention
de la consommation d’alcool dans le monde du rugby : éducateurs et dirigeants face aux
injonctions contradictoires, colloque 3SLF, juin 2022, Rennes
Organisation séminaire
- Boubal C., Le Hénaff Y., Bonnet C., Feliu F., Journée d’étude Produire et réguler les fêtes, 25 et 26 novembre 2021, CERMES3, Villejuif, https://dysolab.hypotheses.org/2698
Equipes du projet
Coordonnateur :
LE HENAFF Yannick
N° ORCID : 0000-0002-9942-6081
Structure administrative de rattachement : Université de Rouen
Laboratoire ou équipe : DYSOLAB, EA 7476
Dites-le nous !