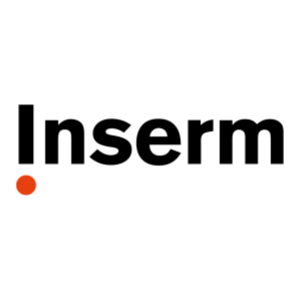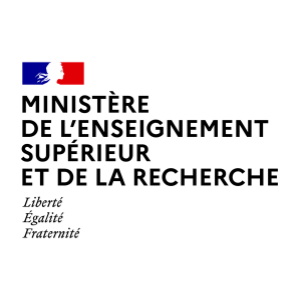Prendre le relai : Les fratries adultes face au handicap mental
Résumé de soumission
Depuis la fin des années 1980, l’espérance de vie de la population dite handicapée mentale n’a cessé d’augmenter, plus rapidement encore que celle de la population handicapée dans son ensemble (Azéma, Martinez, 2003). D’après la DREES, fin 2018 une personne fréquentant un FAM[1] sur cinq est âgée de 60 ans ou plus[2]. Dans ce contexte, l’avenir des adultes dits handicapés mentaux fait l’objet de vives inquiétudes, aussi bien d’un point de vue institutionnel que familial (CNSA, 2010). Ces préoccupations se cristallisent notamment autour de l’expression « Après-parents », qui circule de façon de plus en plus soutenue dans les associations et les institutions. Or, comme l’exprime l’Unapei dans un rapport publié en 2009, les fratries sont souvent considérées comme « le meilleur et le plus naturel relais des parents », bien que la solidarité entre germains ne fasse l’objet d’aucune législation.
En effet, les formes de solidarités encadrées juridiquement comme celles qui existent entre conjoints, ou envers les ascendants, ne concernent que peu les adultes dits handicapés mentaux vieillissant (Renaud, Séraphin, 2004 ; Horwitz et al, 1992). Du fait des larges suspicions qui pèsent sur leur sexualité (Diederich, 1998) et leur parentalité (Gruson, 2012 ; Gaudin, 2008), la plupart d’entre eux sont considérés comme célibataires et n’ont pas d’enfants (Renaud, Séraphin, 2004). Si les frères et sœurs sont ainsi ciblés c’est donc parce qu’ils sont envisagés comme les « parents les plus proches » (Horwitz et al, 1992). Ce travail de thèse sera entre autres l’occasion d’explorer finement cette notion.
De façon plus générale, à travers l’analyse de 76 entretiens menés par monographies de famille, des observations dans quatre institutions agrées pour recevoir des adultes dits handicapés mentaux (FAM, MAS, ESAT, CAJ)[3], dans une association de tutelle publique, ainsi que dans une association de frères et sœurs[4], ce travail de thèse entend décortiquer les enjeux symboliques et l’organisation pratique associés à ce passage de « relais ». L’emploi des méthodes qualitatives permet de rendre compte du regard des parents, des frères et sœurs et des personnes dites handicapées elles-mêmes mais aussi de ne pas trancher trop rapidement les questions du rang et du genre pour montrer comment différents statuts prennent des places et des sens variés selon les configurations. Ces matériaux donnent à voir aussi bien la façon dont les frères et sœurs sont socialisés à la « reprise » que la façon dont les personnes dites handicapées mentales sont socialisées à la « déprise ». Il s’agira de comprendre ce que les frères et sœurs « prennent » de ce relais, ce qu’ils en « laissent » et, plus précisément, qui « prend » quoi. La notion de relais est effectivement peu explicitée, et semble bâtie sur des évidences qu’il s’agira d’objectiver.
De plus, en se concentrant sur deux classes d’âge, les 25-35 ans et les 40-60 ans, cette recherche est un lieu intéressant pour étudier les politiques publiques de prise en charge des personnes handicapées ou dépendantes, qui ont fait depuis quelques décennies de la notion d’aide une notion pivot, autour de laquelle s’articulent différents dispositifs. Or cette aide peut dans la réalité se décliner en de multiples formes d’investissement et de désinvestissement, que cette thèse souhaite explorer en les rapportant aux configurations familiales et sociales qui les structurent.
Enfin, analyser la transmission de ces responsabilités des parents vers les frères et sœurs comme une forme d’héritage, transmis suivant certaines logiques sociales permettra également de considérer l’importance du passage de tutelle (Béliard, Billaud) sans s’y restreindre. En interrogeant par exemple la distribution des responsabilités affectives, quotidiennes et associatives.
[1] Foyers d’accueil médicalisés
[2] Beaucoup d’institutions médico-sociales pour adultes ont ainsi vu la part des personnes de 60 ans et plus, plus que doubler entre 2006 et 2018. Passant respectivement de 6,6% à 21% et 5% à 16% dans les FAM et les MAS (DREES, 2018).
[3] Foyers d’accueils médicalisés, Maison d’accueil spécialisée, Etablissement de services et d’aide par le travail, Centre d’activités de jour.
[4] Ce protocole d’enquête a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’Université Paris Cité (Annexe 8)
Equipes du projet
Coordonnateur :
YVON Sarah
N° ORCID : 0009-0001-9963-9212
Structure administrative de rattachement : Université Paris Cité
Laboratoire ou équipe : Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux, UMR8070)
Dites-le nous !