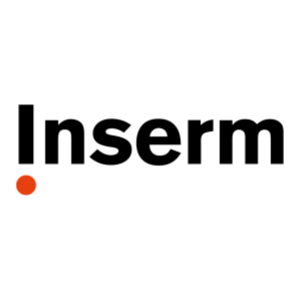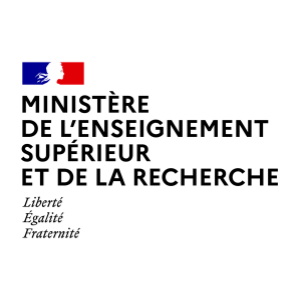Approche neuropsychologique de la pratique de jeux vidéo commerciaux : perspectives et limites
Résumé de soumission
Le sujet de recherche de la présente thèse s’intéresse aux liens qui puissent exister entre la pratique régulière de jeux vidéo et la santé mentale des joueur·se·s selon une perspective neuropsychologique.
Les jeux vidéo ont été reconnus comme pouvant avoir des effets positifs sur la santé mentale et le développement cognitif des joueur·se·s, et certains jeux ont été utilisés comme outil dans des protocoles de prise en charge (médiation thérapeutique, entraînement cognitif, soulagement des symptômes de certains troubles mentaux…).
Le mésusage de jeux vidéo peut en revanche être le signe d’un trouble du jeu vidéo (TJV). Celui-ci se définit non pas par une simple pratique intensive, mais par la perte de contrôle sur le temps de jeu, l’altération qui en résulte sur les sphères importantes du fonctionnement (personnel, social, professionnel, éducatif…), et l’incapacité à réduire sa pratique malgré la connaissance des conséquences négative. La place du jeu a alors un impact significatif et néfaste sur le fonctionnement et le bien-être de la personne. Les recherches cliniques fondamentales ont pu identifier des facteurs individuels associés au TJV, notamment la présence de difficultés neurocognitives au niveau du contrôle inhibiteur, des prédispositions psychologiques (humeur, comorbidités psychiques, mésusage de substances psychotropes…) et la recherche de gratifications particulières dans le jeu. Ces données ont pu être agrégées en modèles, comme le modèle I-PACE de Brand et collaborateurs (2016, 2019).
Le constat de ces deux facettes opposées des interations entre les jeux vidéo et la santé mentale et cognitive pose question, tant sur le plan théorique que pratique en clinique. D’une part, l’utilisation de jeux vidéo peut s’avérer bénéfique comme outil thérapeutique ou de réhabilitation cognitive, et d’autre part, certains usages sont associés à une souffrance psychique notable et des troubles neurocognitifs. L’objectif double de la présente thèse est d’éclaircir cet écart de conséquences de la pratique des jeux vidéo sur la santé psychique et neurocognitive, en détaillant les usages permettant de bénéficier des effets positifs des jeux vidéo, et en améliorant la compréhension clinique du TJV du point de vue neuropsychologique.
Une première partie de cette recherche s’intéressera aux contextes d’usage dans lesquels l’utilisation de jeux vidéo est associée à un gain d’habilités cognitives et une meilleure santé mentale (méthodologie des protocoles de soin, temps, régularité, genres de jeu, gameplay…), grâce à une revue systématique des données de la littérature, afin de proposer une ligne directrice quant à l’usage bénéfique des jeux vidéo et leur indication en contexte de soin.
Une deuxième partie consistera en une enquête en ligne auprès de joueur·se·s régulier·ère·s adultes tout-venant, incluant des questionnaires, des échelles cliniques et une tâche informatisée, visant à explorer les relations de corrélation entre le mésusage de jeux vidéo, les capacités neurocognitives exécutives et des indicateurs de la santé mentale des individus (humeur, comorbidités psychiques, mésusage de substances, qualité de vie…).
La dernière partie de ces recherches se servira des résultats obtenus afin d’élaborer et de tester un protocole d’intervention assistée par un jeu vidéo, auprès d’adultes avec un TJV. Nous testerons l’hypothèse selon laquelle l’utilisation encadrée et thérapeutique de jeux vidéo puisse agir positivement sur les troubles cognitifs et psychiques comorbides du TJV, et ainsi étudier l’évolution des troubles des participant·e·s avant et après le protocole, en comparaison avec un groupe TJV contrôle.
Equipes du projet
Coordonnateur :
GARNOT Chloé
Structure administrative de rattachement : Université de Lille
Laboratoire ou équipe : PSITEC
Dites-le nous !