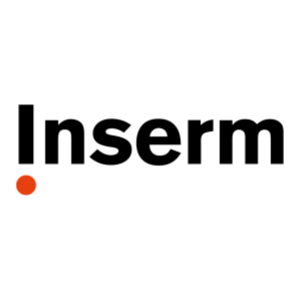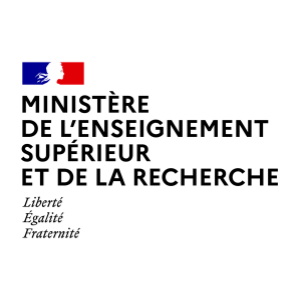Disséquer une prédisposition commune entre dépendance tabagique et schizophrénie
Résumé de soumission
Nous étudierons le rôle des polymorphismes humains dans les gènes des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR). Notre projet est basé sur de solides études d’association à l’échelle du génome (GWAS), confirmées par une méta-analyse, qui relient les polymorphismes mononucléotidiques (SNP) codants et non codants à plusieurs maladies majeures. Nous avons récemment passé en revue les principaux résultats (1). Outre un lien robuste avec le tabagisme (2), ils sont impliqués dans la schizophrénie (SZ) (3), avec une puissance statistique supérieure à certaines des cibles médicamenteuses standard comme les récepteurs de la dopamine; la dépendance à la cocaïne (4), les opioïdes (5), alcool (6), cannabis (7), mais aussi la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) (8), le cancer du poumon (9), la longévité (10) et l’indice de masse corporelle (11). Ils présentent ainsi une cible majeure pour l’intervention pharmacologique, étant prédominants dans la population, avec une fréquence allélique moyenne de 28 %.
Nous proposons de développer et d’utiliser plusieurs systèmes modèles pour étudier les conséquences sur leur fonctionnement et le comportement. Il s’agit notamment de souris transgéniques et de rats transgéniques exprimant un polymorphisme codant fréquent dans le gène CHRNA5, exprimé dans de nombreux types de cellules du cerveau humain (https://human.brain-map.org/), rs16969968, dans la sous-unité α5 nAChR, changeant un aspartate en asparagine en position 398 (D398N, α5SNP).
Nous avons mis en place une imagerie dynamique à deux photons (2P) et trois photons (3P) dans le cortex de souris et de rats éveillés, et commencé à analyser des souris avec l’expression de α5SNP dans le cortex. Nous avons pu montrer et publier (12) que ces souris présentent une « hypofrontalité » similaire aux études IRMf publiées chez des porteurs humains du α5SNP (13). Nous disséquerons plus en détail ce changement d’activité corticale et identifierons les facteurs pour lesquels l’application chronique de nicotine le normalise. Cet effet peut être lié à l’incidence du tabagisme chez les patients psychiatriques, où la nicotine est considérée comme une forme « d’automédication ». Nous compléterons cette analyse par une dissection comportementale avancée, une imagerie cérébrale profonde in vivo et une validation dans des cerveaux transplantés avec des neurones dérivés de cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC).
Nous fournissons une base pour que ces études « humanisées » puissent être étendues à l’aide de nouvelles approches pharmacologiques, et au ciblage de nouvelles voies pour l’arrêt du tabac et la normalisation de la signalisation cholinergique altérée dans les maladies mentales. Les résultats des travaux proposés contribueront à approfondir notre compréhension des altérations synaptiques sous-jacentes, et permettront de créer de nouveaux médicaments, agissant sur les récepteurs génétiquement modifiés, pour progresser vers des traitements personnalisés pour les porteurs des SNP, en explorant un « proto-typique » modulateur allostérique positif (PAM) de l’α5 contenant des nAChR, la galantamine : à faible concentration (~1 µM), elle agit comme un PAM de la réponse cholinergique (14-16). Cela pourrait conduire à de nouvelles approches de développement de médicaments.
Equipes du projet
Coordonnateur :
MASKOS Uwe
Structure administrative de rattachement : Institut Pasteur
Laboratoire ou équipe : Neurobiologie intégrative des systèmes cholinergiques
Dites-le nous !