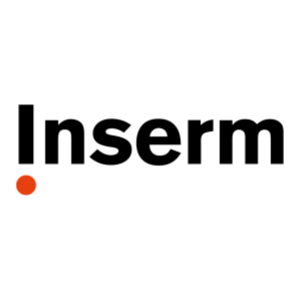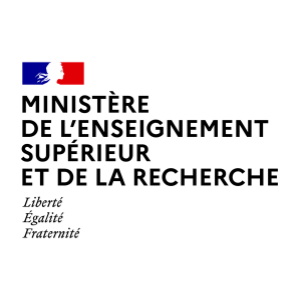Pour une culture de l’hospitalité en santé, expérimenter, théoriser et promouvoir un design d’hospitalité dans les services et les organisations des milieux de soins
Résumé de soumission
A l’heure où la société prend conscience d’un partage de la vulnérabilité sous les effets conjugués de la crise sanitaire de la COVID-19, du déréglément climatique et des guerres, nos institutions publiques sont requises pour leur solidité et leur dévouement aux citoyens. Le système de santé public constitue l’une de ces institutions la plus attendue et la plus respectée par les français et en son sein, l’hôpital public en est la clé de voûte. Or, ce dernier manifeste des signes d’épuisement et de dysfonctionnements qui ouvrent des failles dans lesquelles s’installent parfois des dilemmes éthiques graves quant au tri des patients, crise de confiance, maltraitances et souffrance au travail. Ces fragilités, révélées plus que générées par la crise sanitaire, font échos à la question fondamentale de ce qui fait hospitalité dans les hôpitaux. Cette recherche imagine que ce partage du sentiment de vulnérabilité pourrait inviter les acteurs de la santé à mettre concrètement en oeuvre les conditions pour rendre la valeur hospitalité effective pour tous. Au demeurant, l’OMS a conduit une revue de littérature (Fancourt, Finn, 2019) qui conclut aux effets bénéfiques des disciplines de création et de conception (art, architecture, design) pour la santé, tant physique que mentale des usagers, à partir de l’analyse des éléments de preuve tirés de 900 publications du monde entier. Les impacts évalués concernent aussi bien la prévention que la santé publique, l’autonomie des usagers atteints de maladies complexes et chroniques, la qualité de la relation entre usagers et soignants, la qualité d’expérience tant des usagers que des soignants, les chances de rémission, le rétablissement, la déstigmatisation de la maladie et du handicap dans la société, l’inclusion des plus vulnérables dans le droit commun. L’efficacité de ces démarches reposent sur la participation des parties-prenantes. Or, bien que l’OMS reconnaisse que la prise en compte de l’expérience des personnes vivant une maladie contribue à renforcer leur pouvoir d’agir pour leur rétablissement (OMS, 2023), force est de constater que ces approches sont encore peu développées par les opérateurs hospitaliers et de nombreux concepteurs, designers ou architectes, s’interrogent aujourd’hui sur les manières de saisir ces expériences et de les traduire dans leurs projections créatives. A ce titre, les designers disposent d’outils et de méthodes afin de faciliter la participation des usagers et la collaboration entre les parties prenantes.
Dans cette perspective, nous proposons d’explorer la question de l’hospitalité en considérant le design comme un espace d’expérimentation et d’édification des potentialités de l’éthique de l’hospitalité dont les formes probantes seraient à déployer ultérieurement dans les politiques publiques pour des populations plus larges. Les designers accompagnent en effet l’hôpital à penser ses espaces, ses structures matérialisées mais aussi ses organisations et ses services en mettant l’accent sur l’usage, l’expérience sensible, la participation de toutes les parties-prenantes et le soutien à la qualité des relations. Il s’agit là d’un déplacement important de la culture hospitalière dans la manière de concevoir et de produire son milieu.
Le premier objectif propre au caractère pilote de la recherche consiste à bâtir le partenariat pluridisciplinaire du projet complet de la recherche avec plusieurs laboratoires de recherche dans le champ de l’architecture, du design et de la santé. Déjà identifiés pour leur intérêt pour le secteur de la santé et leur engagement dans une approche épistémologique spécifique de la conception du milieu de soins, ils auront à reformuler et à enrichir le projet de recherche complet et à définir précisément les apports respectifs des chercheuses et chercheurs impliqués et leur méthode de collaboration.
Le deuxième objectif consiste à identifier et documenter les différents terrains de santé permettant, ultérieurement, de conduire une recherche-projet ancrée, à partir d’une pratique itérative d’expérimentations, afin de contribuer à la production de données probantes et au déploiement d’un champ de recherche translationnel utile aux organisations de santé. Les équipes professionnelles de ces terrains seront mobilisées dans la phase pilote de la recherche dans une démarche collaborative. L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille a d’ores et déjà manifesté son intérêt.
Le troisième objectif consiste à traduire les connaissances nouvelles issues du recueil narratif et de l’analyse de l’expérience de la maladie et de la prise en soins de personnes présentant la particularité d’être également des professionnels de la conception (designers et architectes) en pistes de projet. Il s’agira de les traduire dans des supports prototypes susceptibles de soutenir la médiation entre les concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes, designers) et les parties prenantes de la santé (professionnels et usagers).
Nous déposons une candidature pour une recherche pilote d’une durée de 18 mois afin de construire le dispositif partenarial requis par les ambitions du projet et intégrer de nouveaux chercheurs et praticiens et d’identifier et documenter les terrains d’investigation et d’expérimentation auprès de plusieurs établissements sanitaires. Un atelier participatif avec des personnes à la fois concernées par la maladie et dépositaires de la compétence en conception aura pour objet de matérialiser les enseignements du recueil narratif auquel ils auront participé en supports de médiation pour les hospitaliers et les concepteurs. Les résultats de l’ensemble de ces démarches exploratoires, collaboratives et participatives donneront lieu à l’écriture d’un projet de recherche complet qui sera déposé à l’occasion d’un prochain appel à projet. Le schéma méthodologique se structure en trois volets : collaboratif, participatif et exploratoire.
Equipes du projet
Coordonnateur :
DELANOE-VIEUX Carine
Structure administrative de rattachement : Université de Nîmes
Laboratoire ou équipe : UPR Projekt
Autres équipes participantes :
Responsable de l'équipe 2 : LE COZ Pierre
ADES anthropologie bioculturelle, droit, éthique et santé
Responsable de l'équipe 3 : MALZAC Perrine
Espace de réflexion éthique PACA-CORSE
Responsable de l'équipe 4 : BACH Philippe
EVCAU ENSA PVS
Dites-le nous !