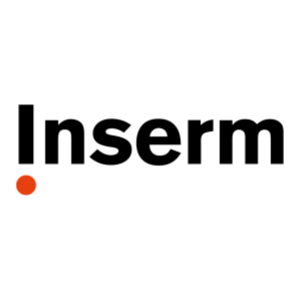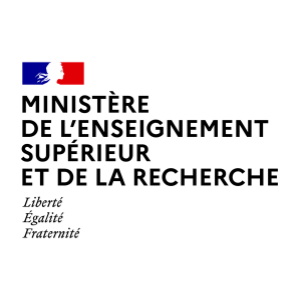De l’émergence de la catégorie à la gestion des parcours de vie des personnes en « situation de handicap complexe » : une analyse des dispositifs innovants portés par LADAPT Essonne
Résumé de soumission
Contexte
En France, à la suite des grandes évolutions qu’a connu le secteur médico-social à partir des années 1970, de nouvelles modalités de prise en charge à destination des personnes en situation de handicap sont progressivement apparues avec le développement des services d’accompagnement. A partir des années 2010 plus précisément, de nombreux dispositifs ont été ouvert pour « coordonner le parcours » de vie des personnes en dehors des institutions spécialisés. Si un certain nombre de recherches se sont penchées sur les dynamiques locales de ces « politiques de coordination » dans le secteur de l’autonomie en France, aucune n’a encore été menée plus précisément dans le secteur du handicap sur ces pratiques professionnelles de coordination.
Objectifs
Au carrefour de la sociologie du travail, de la sociologie des professions et de la sociologie des institutions, l’objectif de cette thèse est de comprendre la nature des pratiques quotidiennes de coordination et la manière dont elles sont traversées par les grandes évolutions politiques et historiques du secteur, et réciproquement.
Méthode
Pour ce faire, cette thèse a été effectuée dans le cadre d’un contrat Cifre avec l’association Ladapt Essonne, qui a ouvert à partir des années 2010 plusieurs services d’accompagnement dont l’objectif est de coordonner les parcours de vie de personnes en situation de handicap dite « complexe » et « sans solution ». En tant que membre à part entière des équipes professionnelles, le doctorant a pu récolter un nombre important d’observations ethnographiques et procéder à des entretiens semi-directifs avec les coordinatrices de parcours. En parallèle, un travail de recherche sur document a été mené pour reconstituer la genèse de ce type de dispositifs et des catégories auxquelles ils se réfèrent.
Perspectives
Finalement, cette thèse se propose de considérer l’acte de coordination comme un acte d’acculturation, au sens anthropologique du terme. Elle permet alors de poser un regard sociologique original sur ces pratiques en interrogeant la dimension culturelle à l’œuvre dans ces métiers. Dans ce cadre, les difficultés d’accompagnement qui peuvent parfois se poser face à certaines familles peuvent alors être considérées comme des résistances à l’acculturation. De plus, la prise en compte des conditions sociales dans laquelle se déroule cet acte permet de rendre compte des logiques d’interpénétration et de métissage, qui laissent entrevoir une relation qui n’est pas aussi asymétrique qu’elle n’y parait à première vue. Enfin, la question des relations partenariales, parfois conflictuelles, peut aussi être considérée comme un phénomène qui résulte des contacts entre des modèles culturels hétérogènes.
Equipes du projet
Coordonnateur :
TASTET Richard
Structure administrative de rattachement : Université Paris Cité
Laboratoire ou équipe : Cermes3
Dites-le nous !