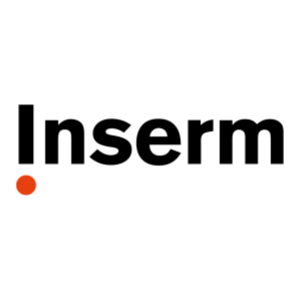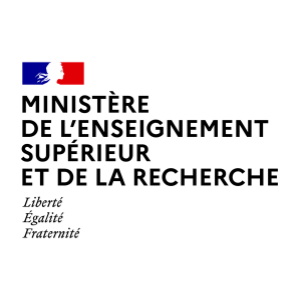EVolution de l’Offre de prise en charge de la Perte d’Autonomie et CHOix des Personnes Âgées (EvOPAChoPA) – Amélie Carrère et Delphine Roy
Résumé de soumission
Contexte. Le vieillissement de la population préoccupe les décideurs publics. Le nombre de personnes nécessitant une assistance devrait augmenter pendant plusieurs années. Symétriquement, il existe des tensions au niveau de l’offre de prise en charge. On observe que le nombre de lits en institution a évolué lentement, de même que le nombre de services proposant de l’assistance au domicile des personnes âgées, en partie expliqué par la faible attractivité des métiers de la prise en charge de la dépendance. En miroir, le recours aux établissements ou à l’aide professionnelle a peu progressé. À ce jour, il n’a pas été clairement décrit si ce faible changement en matière de recours est lié à une offre insuffisante, inadaptée voire trop chère, à une modification des besoins de prise en charge des personnes âgées, ou un changement dans leurs préférences ?
Objectifs. L’objectif de ce projet est dans un premier temps, de quantifier et qualifier précisément l’offre, le recours et les besoins et leur évolution dans le temps. L’offre sera mesurée par les structures et les professionnels qui accompagnent les personnes âgées à leur domicile ou en établissement pour la réalisation d’activité du quotidien. Il sera notamment mis l’accent sur la distinction du lieu de prise en charge (domicile ou établissement) et le type de structure déclinés à un niveau géographique fin (a minima le département) et pour au moins deux dates afin d’apprécier sa mutation. Il s’agira aussi de disposer d’éléments sur la tarification de cette offre. Les besoins des personnes âgées seront mesurés par leurs incapacités dans les activités du quotidien. Dans un deuxième temps, il s’agira de démêler les raisons de la faible progression du recours à ces dispositifs en analysant l’évolution concurrente des besoins, de la structure de l’offre et du recours.
Méthodes. Pour estimer l’offre, nous mobiliserons les données de la Drees (Finess, EHPA et SAE), les données de la DGE (NOVA), les données de la CNAMTS (Amos et PMSI-HAD) et les données Acoss-Urssaf, CnCesu. Elles renseignent les services suivants : salariés de particuliers employeurs, services d’aide et d’assistance à domicile (SAAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), services d’hospitalisation à domicile (HAD), infirmiers libéraux, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) non EHPAD, unités de soins de longue durée (USLD), résidences-autonomie, centres d’accueil de jour et l’hébergement temporaire. Pour estimer les besoins (restrictions dans les activités) et le mode de prise en charge choisi (aide formelle / informelle à domicile ou en établissement), nous mobiliserons plusieurs enquêtes : Vie Quotidienne et Santé (VQS) 2007 et 2014 ; Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées (EHPA) 2007 et 2015 ; Handicap-Santé Ménages (HSM) 2008 ; Handicap-Santé Institutions (HSI) 2009 ; Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE)-Ménages 2015 et CARE-Institutions 2016. Nous analyserons l’évolution des modes de prise en charge à partir de méthodes de décomposition (Oaxaca-Blinder et Yun) pour distinguer ce qui relève de l’évolution des besoins et de l’évolution de l’offre, notamment à travers l’analyse des variations départementales des liens entre besoins, recours et offre.
Perspectives. Les résultats permettront de suggérer des leviers d’intervention pour favoriser les préférences des personnes, qu’elles consistent à rester à domicile ou à entrer en institution, à recourir à une aide informelle ou formelle et à comprendre les inégalités au sein de la population qu’elles soient liées à des différences d’état de santé fonctionnelle, d’entourage, ou d’offre. Ce projet irait de pair avec celui de la DREES concernant la constitution d’une BAse de Données Interadministrative ANnuelle des Esms (BADIANE) dont Amélie Carrère est membre du comité de pilotage. Le projet proposé permettra de définir le champ de cette base de données, de nourrir la réflexion méthodologique pour sa constitution et de vérifier son exhaustivité (en comparant les totaux estimés).
Synthèse finale du projet
SYNTHESE COURTE
CONTEXTE
Près de 2 millions de personnes âgées en France nécessitent un accompagnement en raison d’une perte d’autonomie liée à l’âge. Malgré l’augmentation des besoins, le recours aux dispositifs de prise en charge n’a pas évolué de la même façon à domicile et en établissement. Cette stagnation soulève des interrogations : est-elle le reflet d’une offre insuffisante et inadaptée ? Ou traduit-elle une évolution des besoins et des préférences des individus ? Les enquêtes montrent que la grande majorité des seniors déclarent vouloir vieillir à domicile plutôt qu’en établissement. Dans ce contexte, les politiques publiques françaises ont encouragé un « virage domiciliaire » depuis les années 2000. L’objectif est de favoriser le maintien à domicile par la mise en place de dispositifs d’aide, tout en limitant le recours aux solutions institutionnelles, telles que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
OBJECTIFS
Ce projet répond aux questions de recherche suivantes : Comment ont évolué les déterminants de la demande de prise en charge en établissement (principalement les besoins d’assistance, les ressources, et les préférences) et notamment l’incapacité au cours du temps ? Est-ce que ces évolutions ont eu l’effet escompté sur le recours aux dispositifs de prise en charge ? Si non, pour quelles raisons ? Comment a évolué l’offre en quantité, prix et nature ? Contribue-t-elle à expliquer l’évolution du recours ?
MÉTHODOLOGIE
La principale partie du projet, ayant abouti à la publication d’un article dans Economie et Statistique, repose sur un modèle microéconomique de choix individuel, dans lequel chaque personne compare les différentes options de prise en charge en fonction des coûts, des bénéfices perçus et des contraintes budgétaires. Ce cadre permet d’identifier les facteurs influençant le recours aux dispositifs d’aide, tout en tenant compte des préférences individuelles et des contraintes structurelles de l’offre. Pour quantifier l’évolution des phénomènes observés, on utilise la méthode de décomposition statistique développée par Yun (2004).
La seconde partie du projet est plus descriptive, mais présente l’originalité de rassembler des informations issues d’un grand nombre de bases de données, et de présenter une analyse dans le temps de l’évolution de l’offre – en particulier en Ehpad.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Entre 2008 et 2015, la part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant en établissement a légèrement augmenté, passant de 8,4 % à 9,2 %, soit une progression de seulement 0,8 point. Cette évolution contraste avec la forte croissance des besoins, due notamment au vieillissement démographique et à l’augmentation de la population des 90 ans et plus, qui est passée de 7,9 % à 14,3 % sur la même période.
La décomposition des effets révèle que :
- 80 % de l’évolution s’explique par des changements de composition démographique et sanitaire. L’augmentation des limitations fonctionnelles sévères et la proportion croissante de personnes âgées très dépendantes ont mécaniquement accru les besoins en prise en charge institutionnelle.
- 20 % de l’évolution restent inexpliqués et semblent liés à des facteurs structurels, comme les contraintes d’accès aux établissements (files d’attente, coûts) ou des changements de préférences individuelles en faveur du maintien à domicile.
Les effets identifiés changent de sens selon si on tient compte de l’offre dans les analyses. Il a donc semblé essentiel d’améliorer la mesure de l’offre pour mieux comprendre ces résultats préliminaires. L’analyse de la base FINESS montre que les Ehpad qui ferment sont de plus petite taille que les entrants sur le marché.
Enfin, l’étude des tarifs des SAAD en lien avec leur mode de tarification ouvre de nouvelles pistes d’études. En effet, il semblerait que les services d’aide à domicile ayant des parts de marché plus élevés (toutes choses égales par ailleurs) négocient des tarifs plus élevés, alors qu’on pourrait s’attendre à ce que les plus gros services aient des économies d’échelle leur permettant de réduire leur coût. On constate enfin que le tarif négocié une fois tenu compte des caractéristiques des services est plus élevé dans les départements « riches » au sens du potentiel fiscal.
APPORTS OU IMPACTS POTENTIELS
Ce projet permet d’apporter des éléments de contexte importants dans le cadre de la politique du virage domiciliaire, mise en œuvre par les pouvoirs publics depuis les années 2000. La mise en perspective du recours aux établissements et services montre que les effets d’une politique d’offre ne sont pas univoques mais qu’il faut prendre en compte les interactions entre offre (yc accessibilité géographique et financière) et demande.
Il est à noter que les questions de recherche ainsi soulevées, et les exploitations de données initiées dans le projet EvoPAChoPA, ont été poursuivies, dans les projets EQUIDEC (IRESP) et EQUIDEC-2 (ANR), ainsi que dans le projet THEMIS, auxquels a participé Amélie Carrère, première porteuse du projet EvoPAChoPA
Equipes du projet
Coordonnateur :
ROY Delphine
N° ORCID : 0000-0001-5938-4617
Structure administrative de rattachement : PSE – Ecole d’Economie de Paris
Laboratoire ou équipe : Institut des politiques publiques (IPP)
Dites-le nous !