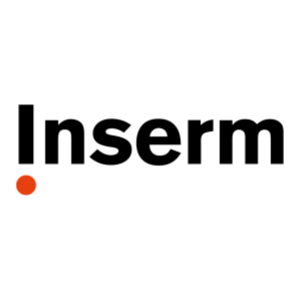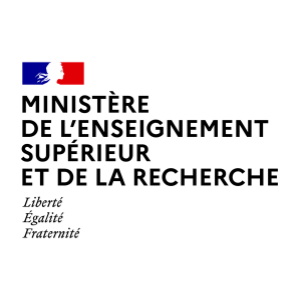L’usage des activités physiques dans la prise en charge des addictions (APhyChaddi) – Yannick Le Hénaff
Résumé de soumission
Contexte
Alors que les activités d’éducation à la santé comme l’Activité physique adaptée (APA) soient considérées comme des ressources potentielles dans la trajectoire d’un certain nombre de patients, la littérature montre que le soin est un espace d’actualisation des inégalités sociales (Darmon, 2021 ; Loretti, 2021 ). Ces activités de soin ou de soin de support structurent des espaces où faire preuve de sa bonne moralité sanitaire et plus encore, des espaces de reconnaissance de son expertise est nécessaire (Arborio & Lechien, 2019 ; Bruneau et coll., 2021 ).
Dans ce contexte, la recherche APhyChAddi rend compte de la manière dont l’Activité physique adaptée (APA) est mise en place dans les établissements de soin d’addictologie, et réappropriée par les patients sur le moment du dispositif et à plus long terme. Elle est originale par l’éclairage multi-situé qu’elle propose. Nous considérons à la fois l’organisation et la place de ces dispositifs d’APA dans les établissements de cure, mais aussi son appropriation par les patients au regard des conditions d’existence et des expériences passées de ses bénéficiaires, appréhendant particulièrement leur trajectoire de consommation, leur parcours de soin mais aussi les interactions avec leur trajectoire sportive antérieure. A ce titre, l’appréhension des activités physiques tout au long de la vie est un prisme intéressant pour travailler les trajectoires biographiques de ces enquêtés (Le Hénaff, Héas, 2022 ). Dans cette étude, l’ethnographie des programmes d’APA combinée aux récits de vie des patients permet de saisir les effets réciproques et combinés des dispositifs et des dispositions. Notre enquête montre ainsi la diversité des formes d’engagement dans ces dispositifs, mais aussi la diversité de ces dispositifs. Négociations, réappropriations ou bien encore détournements sont légion.
Méthodologie
Nous analysons la mise en œuvre de l’APA en addictologie à partir de monographies des programmes qui sont développés au sein de deux cliniques localisées dans deux aires géographiques différentes (Île-de-France et Occitanie). A ce titre, sept professionnels ont été interrogés et un peu plus de 200 heures d’observation en séance d’APA ont été réalisées durant huit mois. Ces observations se sont couplées à 53 entretiens biographiques de 2h en moyenne qui ont été menés auprès de 34 patients sur les deux cliniques. Deux entretiens ont été réalisés dans la mesure du possible pour chaque enquêté : l’un au cours du séjour et un second à la fin de la cure, voire après la sortie. Ainsi, nous avons interrogé l’évolution de l’engagement des patients en APA tout au long du séjour.
Une première partie revient sur la structuration de l’APA dans ces deux cliniques.
Elle est nécessaire, car elle sert la compréhension des pratiques des patients analysées comme le point de rencontre entre leurs trajectoires biographiques et les règles, normes et valeurs de ce dispositif. Dans cette partie nous faisons l’hypothèse que les relations entre soignants et les EAPA structurent des propositions de prise en charge bien différentes. La deuxième partie porte l’étude de trois cas qui éclaire les conditions et processus d’engagement de patients dans l’APA et plus largement dans le soin. Elle répond à l’hypothèse d’un engagement socialement situé qui se lit de façon combinée avec la manière de vivre la cure. Enfin, la troisième partie se focalise sur les patients que nous nommons « sportifs » pour interroger l’effet de leurs expériences corporelles préalables (sportives, somatiques, de soin, de consommation) sur la manière dont ils vivent et pratiquent l’activité physique dans un modèle de soin. Nous tentons alors de démontrer le poids des expériences corporelles dans l’appropriation des propositions hétérogènes de l’APA. Nous démontrons également l’évolution des pratiques d’APA et leur signification à mesure que le corps se répare.
Résultats
L’APA peut être considérée comme une activité sentinelle, ayant fonction de surveillance de l’implication thérapeutique des patients. Cette activité est en effet corrélée par l’ensemble des professionnels de santé à une preuve de l’engagement dans les soins. Et cela, alors même que se déclinent des propositions variables d’APA marquées par différents types d’activités engageant une organisation variable des exercices et de leur intensité selon les cliniques et les professionnels. L’organisation même de cette APA active – c’est l’un de nos résultats marquants – des marqueurs de distinction sociale par le soin, ou au contraire renforce la résignation et l’érosion du sentiment de prise en charge.
Ces dispositifs d’APA sont particulièrement investis par deux grandes catégories de résidents : ceux à même de pratiquer une activité physique en toute autonomie et ceux engagés dans les normes du soin telles que véhiculées par l’institution. Ce sont alors les fractions les plus hautes des classes moyennes et populaires ou les individus disposant d’un capital sportif qui s’insèrent le mieux dans ces dispositifs d’APA ; ce qui est congruent avec les analyses de McLean (2015 ) dans des établissements se rapprochant des CAARUD aux Etats-Unis. Ces modalités de surveillance (et de disciplinarisation des corps) sont investies par les plus insérés socialement (Schmitt & Jauffret-Roustide, 2018 ). Cette responsabilisation par les soins, qui s’inscrit dans une délégation des soins aux patients, est pour les professionnels de santé la démonstration d’un individu rationnel et autonome dans la gestion de sa maladie. A contrario, ne pas correspondre aux comportements attendus par l’institution a des impacts sur la prise en charge dans la clinique (Loretti, 2020 ), mais aussi à plus long terme sur la trajectoire du malade. Ici, il ne s’agit pas seulement d’être investi, mais aussi de l’être selon des conduites qui font sens pour les professionnels. L’APA est aussi et très souvent une référence classante pour ces résidents, et particulièrement pour les hommes. Elle fait écho à des capacités de rebond, de remotivation après des traumatismes, largement valorisées par l’équipe soignante. Cette distinction sociale n’est pour autant pas le seul élément explicatif ; il est en effet nécessaire de prendre également en considération temporalités, trajectoires et significations de la maladie. Pour ce qui concerne les temporalités courtes, celles de la prise en charge dans la clinique, une première phase de « dépouillement biographique » est par exemple généralement observable. A ce moment, la clinique est d’abord un espace où souffler et se reposer (Langlois, 2013 ). L’engagement comme le désengagement dans le soin et dans l’APA doivent ainsi être appréhendés de manière processuelle et non évolutionniste.
Les enquêtés identifiés comme « sportifs » composent le corpus sur lequel s’appuie cette troisième partie. Ces « patients sportifs » se distinguent des autres par leurs pratiques régulières de l’APA et surtout par leurs pratiques sportives autonomes au sein de la clinique, hors des séances dédiées. L’entrée par les expériences sportives et plus largement corporelles permet d’analyser finement la mise en jeu du capital culturel parce qu’elle interroge la confrontation des dispositions sportives des patients dans le contexte d’une AP pensée dans, par et pour le soin. En effet, les pratiques de l’APA sont analysées « au croisement des propriétés sociales des acteurs et des propriétés sociales des contextes dans lesquels ils inscrivent leurs actions » (Darmon, 2006 ). Nous relions pour cela les ressorts de la pratique d’APA et les effets des socialisations passées (Forté, 2021 ; Jacolin Nackaerts, 2018 ; Knobé, 2019 ) appréhendées dans une socialisation plurielle (Lahire, 2012 ) par la famille et les proches, les clubs sportifs, le sport de haut niveau ou encore le soin et la consommation. En toile de fond, nous montrons que les dispositions façonnées par ces socialisations composent un ensemble de capitaux inégalement distribués parmi les patients (Bourdieu, 1994 ; Coulangeon, 2012 ). Les pratiques sportives au cours des socialisations préalables participent à façonner et faire évoluer des rapports aux corps et à la pratique physique différents et socialement situés. Deux groupes de patients sportifs se distinguent par leurs pratiques physiques à l’extérieur comme à l’intérieur de la cure. Le premier groupe se distingue par des pratiques sportives intensives et un rapport au corps fonctionnel, la valorisation de l’effort physique opérant dans la stabilisation de leur position sociale. Dans ce premier groupe, les enquêtés sont caractérisés par leur provenance (quartiers populaires) ou par la pratique du sport de haut niveau, laissant percevoir la construction d’une injonction à l’effort physique dès l’enfance et qui se poursuit à l’âge adulte dans une perspective réputationnelle pour les uns et de performance pour les autres. Cette conception se différencie de l’autre groupe caractérisé par l’investissement des enquêtés dans des activités sportives nombreuses et diversifiées dans l’enfance, des AP porteuses d’enjeux éducatifs forts dans la socialisation familiale. Rigueur et hédonisme se conjuguent dans leur trajectoire sportive et leurs expériences corporelles spécifiques, façonnant un rapport au corps davantage pensé dans sa dimension sanitaire. Cette conception hédoniste est plutôt caractéristique des patients sportifs des classes moyennes et populaires culturelles. L’appropriation de l’APA en cure entre les deux groupes de sportifs semble moins relative à la nature des activités physiques proposées qu’à la manière dont ils se saisissent « de la forme scolaire » (Darmon, 2021 op. cit.) déclinée dans l’APA où toute expérience sociale se doit d’être un processus d’éducation, une occasion d’enseigner ou d’apprendre. Ce contexte favorise les plus dotés en capital culturel, voire en « capital culturel de santé » (Shim, 2010 ). Pour les patients sportifs du premier groupe, l’entrée en cure pare à l’altération du corps. Les dispositions sont constitutives d’un rapport instrumental au corps (Boltanski, 1971 ) qui se traduit par la réalisation d’efforts physiques intenses et fréquents au sein de la cure et la perception d’un décalage plus ou moins subi avec les propositions d’APA dans la clinique de Villedusud. Pour le deuxième groupe qui se caractérise par un rapport au sport hédoniste, la consommation de substance semble revêtir des conséquences plus importantes quant à leurs conditions d’existence et à la perte d’identité associée, deux éléments qui participent à leur volonté d’intégrer une clinique de soin. Ces dispositions corporelles s’actualisent voire se renforcent alors dans le cadre de l’APA en cure, présentée comme une activité sanitaire et éducative.
Impacts et perspectives
Notre travail a pour intérêt de montrer combien le niveau de ressources possédées et les dispositions hygiénistes et hédonistes qui composent le capital culturel donnent la possibilité aux patients de se projeter au sein mais aussi en dehors des murs de l’institution et de concevoir le travail de soin à mener sur la durée et par l’activité physique. A contrario, le manque de ressources et les conditions d’existence complexes pèsent sur la construction d’une forme de méfiance et d’un rapport circonspect au soin. Coupler les dimensions conjoncturelles et socialisatrices pour analyser les modes d’appropriation de l’APA favorise leur compréhension nuancée, allant bien au-delà des seuls ressorts motivationnels. Ces résultats ne sont pas sans rappeler les analyses qui s’accumulent autour des inégalités sociales encore à l’œuvre dans le soin, et notamment en lien avec les attentes d’expertise patient et la mobilisation d’un savoir d’expérience dans le soin (Gaborit et coll., 2021 ; Forté, 2021).
Ce travail de recherche constitue à ce titre une contribution originale aux travaux actuels démontrant la force des expériences sportives pour entrer dans un dispositif d’APA. Il complète l’analyse en pointant les fluctuations des pratiques durant la cure en les rapportant aux rapports au sport et au corps. Notre étude montre ainsi l’importance de penser l’APA pour l’hétérogénéité des patients. Par-delà le manque de pratique physique, il s’agit de sortir de la dualité AP et sédentarité pour concevoir les dynamiques culturelles associées, celles-ci pesant considérablement dans la façon de vivre l’APA et de se l’approprier.
Synthèse finale du projet
Productions scientifiques et communications (Liste non exhaustive)
Communications dans le cadre de congrès et de colloques
- Le Hénaff Y., Gaborit E., Activités physiques en addictologie, séminaire, 14 janvier 2022, Cermes3 Paris.
- Le Hénaff Y., Gaborit E., L’engagement dans l’APA en clinique d’addictologie : analyse de 3 idéaux-types de patient.es ». Atelier : « Les nouveaux publics du sport-santé, Rencontre Sport Santé, le lundi 10 octobre 2022, Paris.
- Gaborit E., Le Henaff Y., Modalités de l’activité physique en addictologie et appropriation différenciée de la pratique chez les patients, les enjeux des jeux, 13 au 15 décembre 2022, Montpellier.
- Gaborit E., Le Hénaff Y., (2023), Adapted physical activities and addictology: analyzing the patient’s engagement, INTERNATIONAL SOCIOLOGY OF SPORT ASSOCIATION (ISSA), 14-17 août, 2023, à Ottawa (Canada).
- Gaborit E., Ce que fait un dispositif d’APA à l’hôpital psychiatrique : le point de vue des usagers d’un service d’addictologie, Cours séminaire ouvert IFERISS-IEP « Enjeux de santé publique », 8 Nov 2022, Toulouse.
Séminaires et comités de pilotages
Organisation de séminaires d’équipes et de COPIL pendant la durée du projet.
Réunions avec les acteurs de terrains.
Liste des communications au grand public
Une restitution de notre enquête auprès des professionnels des cliniques investiguées est prévue à la rentrée 2023.
Cette étude est également l’objet de plusieurs cours magistraux dans le cadre des séminaires ouverts à l’IEP de Toulouse, dans le cadre de la formation Staps filière APA à la F2SMH de Toulouse.
Equipes du projet
Coordonnateur :
LE HENAFF Yannick
N° ORCID : 0000-0002-9942-6081
Structure administrative de rattachement : Université de Rouen
Laboratoire ou équipe : DYSOLAB, EA 7476
Dites-le nous !