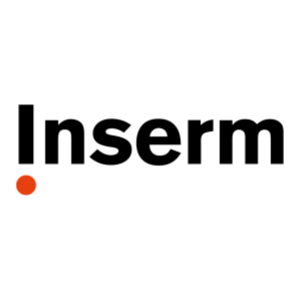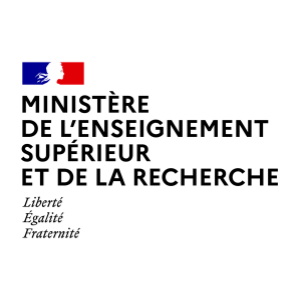Organisation des soins et inégalités sociales face au dépistage du cancer du col utérin : étude de l’offre de soins, du dépistage organisé, de la continuité de l’équipe soignante et du sexe du médecin traitant au sein de la cohorte Constances (OrgaCol) – Laurent RIGAL
Résumé de soumission
Contexte : Quel que soit le lien entre système de soins et inégalités sociales de santé, les services de santé ou leur organisation ne devraient pas contribuer à la construction ou au maintien de disparités. La prévention ayant été identifiée comme un des leviers pour lutter contre ces inégalités, le système de soins devrait permettre la dispensation de soins préventifs de la façon la plus égalitaire possible. En théorie le cancer du col utérin devrait pouvoir être éradiqué par la mise en place de mesures préventives comme le dépistage par frottis. Cependant, en plus d’être insuffisante, la participation au dépistage est très différenciée socialement en défaveur du bas de la hiérarchie sociale où s’accumulent pourtant les facteurs de risque à ce cancer.
Plusieurs caractéristiques du système de soins sont connues pour être associées à une participation plus élevée au dépistage des cancers gynécologiques. Les taux de participation sont ainsi plus importants dans les territoires où l’offre de soins est plus élevée, en termes de densité médicale en généralistes et en gynécologues. Certaines études internationales (mais pas toutes) ont mis en évidence que les pays avec un dépistage organisé (DO) au niveau national n’avaient pas d’inégalités sociales face au dépistage, contrairement à ceux qui n’en n’ont pas. Une meilleure coordination des soins, et notamment une plus grande continuité dans le temps de l’équipe soignante autour d’une personne, sont associés à des soins de qualité supérieure et en particulier un dépistage par frottis plus fréquent. Enfin, les médecins femmes s’impliquent davantage dans la prévention, et en particulier dans le dépistage des cancers gynécologiques, que leurs confrères masculins. Nous faisons l’hypothèse que ces différentes caractéristiques, en plus d’augmenter la participation au dépistage des cancers, seront associées à des gradients sociaux moins importants.
Objectifs : Analyser l’association entre les gradients sociaux face au frottis et quatre grandes caractéristiques du système de soins : l’offre de soins (objectif 1), l’existence d’un dépistage organisé (objectif 2), la continuité des soins (objectif 3) et le sexe du médecin traitant (objectif 4). Par ailleurs, les disparités sociales de recours au gynécologue, au généraliste, au DO (présent sous forme expérimentale dans certains départements) et aux sages-femmes pour la prescription de frottis seront également étudiées pour comprendre les phénomènes de sélections sociales à l’œuvre dans le système de soins.
Méthodes : Les données qui seront analysées ont été recueillies lors de l’inclusion dans la cohorte Constances (échantillon aléatoire de la population française âgée de 18 à 69 ans à l’inclusion et représentatif des personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale). Un échantillon de plus de 24 000 femmes éligibles au dépistage est actuellement disponible. Le statut « à jour » du dépistage sera déterminé à partir du questionnaire d’inclusion et des données de remboursement. L’offre de soins sera définie par des indicateurs contextuels comme l’accessibilité potentielle localisée, la présence d’un DO sera déterminée via l’adresse des personnes participantes, la continuité des soins sera estimée par des indicateurs calculés à partir du Sniiram, et le sexe du médecin traitant sera issu des informations fournies par l’Assurance maladie.
Les inégalités sociales face au frottis seront estimées pour divers indicateurs de position sociale par des mesures agrégées absolues et relatives. Pour répondre aux objectifs, des tests d’interactions seront effectués. De même, l’étude du prescripteur du dernier frottis sera menée.
Perspectives : Nos résultats apporteront de nouveaux arguments pour mettre en place des politiques de lutte contre les inégalités d’offre de soins. Ils permettront d’avoir de nouveaux éléments d’évaluation du DO et concernant l’intérêt de la continuité des soins. Enfin, montrer que certaines caractéristiques personnelles du médecin traitant – le sexe dans notre cas – peuvent conduire à des inégalités sociales face aux soins devrait familiariser les généralistes à cette problématique et les mobiliser pour agir.
Synthèse finale du projet
Contexte et objectifs du projet
Quel que soit les liens entre système de soins et inégalités sociales de santé, les services de santé ou leur organisation ne devraient pas contribuer à la construction ou au maintien de disparités. La prévention ayant été identifiée comme un des leviers pour lutter contre ces inégalités, le système de soins devrait permettre la dispensation de soins préventifs de la façon la plus égalitaire possible. En théorie le cancer du col utérin devrait pouvoir être éradiqué par la mise en place de mesures préventives comme le dépistage par frottis. Cependant, en plus d’être insuffisante, la participation au dépistage est très différenciée socialement en défaveur du bas de la hiérarchie sociale où s’accumulent pourtant les facteurs de risque à ce cancer.
Plusieurs caractéristiques du système de soins sont connues pour être associées à une participation plus élevée au dépistage des cancers gynécologiques. Les taux de participation sont ainsi plus importants dans les territoires où l’offre de soins est plus élevée, en termes de densité médicale en généralistes et en gynécologues. Certaines études internationales (mais pas toutes) ont mis en évidence que les pays avec un dépistage organisé (DO) au niveau national n’avaient pas d’inégalités sociales face au dépistage, contrairement à ceux qui n’en n’ont pas. Une meilleure coordination des soins, et notamment une plus grande continuité dans le temps de l’équipe soignante autour d’une personne, sont associés à des soins de qualité supérieure et en particulier à un dépistage par frottis plus fréquent. Enfin, les médecins femmes s’impliquent davantage dans la prévention, et en particulier dans le dépistage des cancers gynécologiques, que leurs confrères masculins. Nous faisons l’hypothèse que ces différentes caractéristiques, en plus d’augmenter la participation au dépistage des cancers, seront associées à des gradients sociaux moins importants.
Les objectifs de ce projet étaient les suivants : analyser l’association entre les gradients sociaux face au frottis et quatre grandes caractéristiques du système de soins : l’offre de soins (objectif 1), l’existence d’un dépistage organisé (objectif 2), la continuité des soins (objectif 3) et le sexe du médecin traitant (objectif 4). Par ailleurs, les disparités sociales de recours au gynécologue, au généraliste, au DO (présent sous forme expérimentale dans certains départements) et aux sages-femmes pour la prescription de frottis seront également étudiées pour comprendre les phénomènes de sélections sociales à l’œuvre dans le système de soins.
Méthodologie utilisée
Les données qui ont été analysées ont été recueillies lors de l’inclusion dans la cohorte Constances (échantillon aléatoire de la population française âgée de 18 à 69 ans à l’inclusion et représentatif des personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale). Un échantillon de plus de 24 000 femmes éligibles au dépistage était disponible. Le statut « à jour » du dépistage a été déterminé à partir du questionnaire d’inclusion et des données de remboursement. L’offre de soins a été définie par des indicateurs contextuels comme l’accessibilité potentielle localisée, la présence d’un DO a été déterminée via l’adresse des personnes participantes, la continuité des soins a été estimée par des indicateurs calculés à partir du Sniiram, et le sexe du médecin traitant était issu des informations fournies par l’Assurance maladie.
Les inégalités sociales face au frottis ont été estimées pour divers indicateurs de position sociale par des mesures agrégées absolues et relatives. Pour répondre aux objectifs, des tests d’interactions ont été effectués. De même, des analyses concernant le prescripteur du dernier frottis, les trajectoires de dépistage (évolution temporelle du statut vis-à-vis du dépistage qui peut être : sous-dépistée, dépistée et sur-dépistée) et le nombre annuel de frottis ont été menées.
Principaux résultats obtenus
Les résultats intermédiaires (car des analyses avec un échantillon plus large sont en cours) en lien avec chacun des objectifs sont les suivants :
Objectif 1 : L’offre de soins de médecine générale estimée par la densité est apparue indépendante du taux de dépistage, alors que l’offre de soins en gynécologie était associée d’une part à moins de sous-dépistage et d’autre part, et de façon plus importante en amplitude, à davantage de sur-dépistage. En matière d’inégalités sociales, il n’a pas été observé davantage d’inégalités sociales face au sous-dépistage selon le prescripteur du frottis (généraliste ou gynécologue). Par contre les femmes consultant des gynécologues présentaient un risque de sur-dépistage socialement différentié en défaveur du haut de la hiérarchie sociale. Ce gradient n’existait pas chez les femmes suivies par un généraliste.
Objectif 2 : La comparaison des départements avec et sans DO n’a pas mis en évidence de différence en termes de taux de dépistage. En matière de gradients sociaux, seul le gradient relatif au niveau d’études était plus faible (et quasiment nul) dans les départements avec un DO.
Objectif 3 : L’indice de continuité de l’équipe soignante d’une année sur l’autre était très légèrement associé à davantage de dépistage et donc à moins de sous-dépistage et plus de sur-dépistage. Aucune association avec des inégalités sociales de dépistage n’a été observée.
Objectif 4 : Le sexe masculin du médecin traitant était associé à légèrement plus de sous- dépistage ainsi qu’à un peu plus de d’inégalités socioéconomiques mais sans que celles-ci ne soient significatives.
Par ailleurs ce projet a permis de mettre en évidence les éléments suivants :
- En cas d’accumulation de plusieurs facteurs défavorables au dépistage, ceux-ci peuvent avoir un effet synergique, c’est-à-dire que la combinaison de ces désavantages produit des effets supérieurs à leur somme. Ainsi une « double peine » pour les femmes en surpoids/obésité, ainsi que pour celles ayant une origine migratoire étrangère a été mise en évidence. Ces femmes sont d’une part plus souvent sous-dépistées et d’autre part victimes d’inégalités sociales plus marquées.
- L’étude des trajectoires de dépistage a mis en évidence une certaine pérennité du rapport au dépistage. En plus d’être relativement stables dans le temps, les types de trajectoires adoptés par les femmes sont très socialement différentiés et associés à l’offre gynécologique
Impacts potentiels de ces résultats et perspectives pour la décision publique
De façon générale, mettre en lumière que certains soins sont dispensés de façon socialement différenciée est d’autant plus important que parmi les soignants et les politiques, comme dans
le reste de la population, la question des inégalités sociales de soins tend à être spontanément confondue avec celle de l’accès aux soins des personnes les plus précaires ou les plus défavorisées – sur laquelle il est plus aisé de dégager un consensus moral et politique. Nos résultats mettent en évidence que des différences sociales existent y compris parmi les personnes qui ont recours aux soins et ne sont pas en marge de la société (population des participantes à Constances), et surtout que ces différences ne sont pas indépendantes de la façon dont les soins sont collectivement organisés.
Par ailleurs, ces résultats confortent le choix de la généralisation du DO. Ils invitent à penser un dépistage plus personnalisé, notamment selon l’histoire antérieure de dépistage des femmes. L’invitation au dépistage d’une femme « jamais dépistée » pourrait être différente de celle d’une femme « régulièrement dépistée jusqu’à présent » dans la mesure où les obstacles à leur dépistage sont sans doute très différents. Les campagnes d’information en lien avec le dépistage devraient également informer les femmes du risque du sur-dépistage, qui pourrait également faire l’objet d’une analyse médico-économique.
Enfin les inégalités sociales face au frottis selon le sexe du médecin traitant constituent un argument pour alerter les hommes médecins sur la nécessité de dépasser ce frein « naturel » à la réalisation du dépistage. Des actions de formation (initiale auprès des jeunes médecins et continue auprès des plus âgés) pourraient être mises en place pour inviter les généralistes à davantage dissocier la prescription de l’acte de sa réalisation. L’objectif de ces formations pourrait être de sensibiliser les médecins au fait qu’ils devraient s’intéresser à la réalisation des frottis de dépistage même s’ils n’en pratiquent pas eux-mêmes.
Equipes du projet
Coordonnateur :
RIGAL Laurent
Structure administrative de rattachement : Université Paris-Sud
Laboratoire ou équipe : CESP Inserm U1018 Equipe Sexualité et Soins
Autres équipes participantes :
Responsable de l'équipe 2 : OLEKHNOVITCH Romain
Cohortes épidémiologiques en population-UMS 011 Inserm-UVSQ
Dites-le nous !